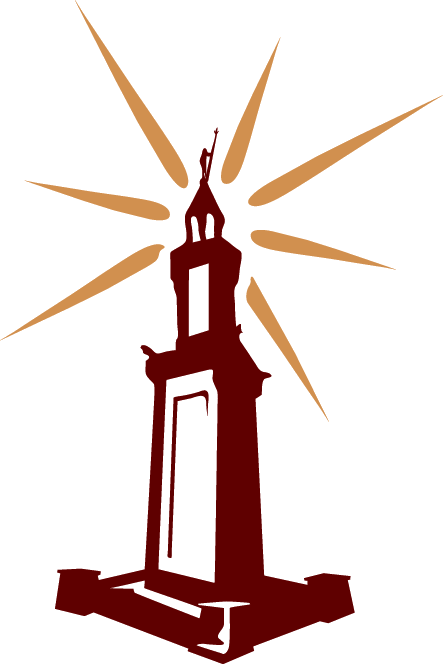Marcel Detienne
Des Grecs donc, parmi les Amérindiens, Indigènes ou natives, les Amérindiens font encore partie de certains paysages du Brésil. Malgré les conquêtes, les entreprises coloniales, ils n’ont pas le même statut que les Indiens d’Amérique du Nord. Car le Nord refuse, aujourd’hui encore, d’entendre parler d’autochtones : trop dangereux ; il refuse, comme la France où les droits des peuples autochtones ne sont toujours pas reconnus : chacun comprend pourquoi…. De fait, « nous » n’avons pas d’autochtones en France. Peut-être cela veut-il dire que tout le monde y est spontanément autochtone !
Entre Amériquains et Grecs, je dirais plutôt entre Amériquains et hellénistes, les relations sont anciennes ; et elles ont été intenses au XVIIIème siècle pour les philosophes, et pour les missionnaires—deux catégories actives, en un temps où « civilisé » n’a pas le même sens qu’aujourd’hui, car civiliser, c’est d’abord convertir.
La France a très tôt identifié l’Américain comme un ennemi (on a très bien fait l’histoire généalogique de cet anti-américanisme); on a dit aussi—et il faut toujours le redire—que la différence engendre souvent la haine, dès lors que cette différence se veut identité et, qui plus est, enracinée dans les idées aujourd’hui reçues, en droite extrême, à leur point culminant, où nous nous trouvons ; dans un tel contexte, les savoirs risquent de ne plus guère communiquer, même au simple étiage de l’information.
Amené à comparer par goût des autres, et de la pensée des autres en particulier—de l’anthropologie en d’autres termes—il m’avait donc semblé utile de faire discrètement l’archéologie de la mythologie comparée.
Sans remonter jusqu’au XVIème siècle voire au Moyen-âge, le XVIIIème est rempli de débats philosophiques autour des Anciens—nos Anciens—confrontant les premiers temps de l’Antiquité, d’une part, et les premiers habitants du Nouveau Monde, de l’autre. Débats entre linguistes, anthropologues, philosophes ; débats menés sans relâche et qui concernent très directement ce qui plus tard est dénommé, dans les livres que nous lisons, « Mythe et pensée », « Pensée mythique et pensée rationnelle », ou encore « Du mythe à la raison », pour n’évoquer que deux ou trois titres connus.
Levi-Strauss est resté longtemps silencieux sur les Grecs anciens, alors que la science des civilisations et l’anthropologie, si volontairement comparative, s’était posé relativement tôt la question : Anthropology and the Classics, titre d’un volume paru à Oxford en 1905. Un projet que j’ai repris à nouveaux frais en 2005 à Johns Hopkins dans un débat-colloque pour comparatistes.
Dans nos sociétés occidentales à racines gréco-romaines-chrétiennes, il semble pourtant que les usages publics des Grecs, entre Heidegger, les Nazis, et les droites extrêmes d’aujourd’hui et de demain devraient retenir l’attention des historiens, comme des anthropologues et des philosophes. J’ai été rapidement conduit à m’y intéresser, en cherchant à faire l’archéologie de la mythologie—la mythologie comme catégorie—ainsi que du mythe comme « notion ».
Inéluctablement, l’analyse structurale des mythologies, conduite par Lévi-Strauss dans les années 60 à 80, devait un jour buter sur la question des Grecs chez les Amérindiens. Qu’en est-il donc des Grecs emmenés par un philosophe de formation – ce qu’est Lévi Strauss – dans son premier exil au Brésil, puis plus tard en Amérique du Nord, et qu’en est-il des Grecs ramenés – qui sait ? – dans ses bagages, à son retour en Ile de France – dans la section des Sciences Religieuses des Hautes Etudes, à la Sorbonne. Quelque trente ans après Anthropology and the Classics, Lévi-strauss, en quête d’un poste, s’en va enseigner un peu de cette sociologie , mi-comtienne, mi-durkheimienne que le Brésil aime encore aujourd’hui cultiver en sciences humaines – il y a tout un réseau actif entre Paris et Sao Paolo. Voilà donc les Grecs en presqu’Amazonie.
Commençons par les Grecs. D’évidence ils constituent déjà depuis longtemps, une totalité, un ensemble de valeurs, un héritage culturel global. De fait les Hellènes se révèlent sous la forme insolite d’une totalité, au dix-huitième siècle, entre la ville de Dresde et la Rome des statues du Belvédère, les deux pôles culturels d’un bibliothécaire luthérien, converti à la religion catholique qui se nomme Johann Joachim Winckelmann. Ledit Winckelmann est un compilateur né, il s’est montré particulièrement doué pour la fiction en inventant une Grèce qui aurait été une nation à part entière, une Grèce qu’il n’a bien sûr jamais connue, car alors la Grèce était asservie par les Turcs, et seuls quelques monastères transmettaient encore la culture ancienne, perdus au milieu de villages à population grandement inculte. Cette belle totalité, baptisée « Les Grecs » – dans l’Histoire de l’Art de Winckelmann – qui va devenir nos Grecs au XIXème siècle, est donc une invention, une fabrication, comme on en voit ailleurs de si bien faites…La Suisse, par exemple, qui, à la fin du XIXème siècle, se donne six siècles d’ancienneté… ou encore l’Allemagne, avec la Prusse victorieuse en 1870 de Napoléon III; et la France aussi bien, quand elle se découvre Nation, après l’instauration de la République, celle des trois couleurs et des premiers 14 juillet, si importants pour Durkheim.
À en croire Winckelmann, le peuple grec à sa naissance avait manifesté une originalité, dont les couleurs, les qualités particulières faisaient de lui naturellement le socle d’une nation. Pareille singularité tient à ce que le Grec naît libre et d’une terre privilégiée (le compilateur de Dresde répète cela une bonne dizaine de fois, tant dans sa correspondance que dans ses textes publiés), une terre privilégiée par son climat, la douceur des cieux, les vents frais, des vents élyséens : l’importance du climat est fondamentale au XVIIIème siècle, pour interpréter, pour comprendre les groupes humains. Les Grecs poussent donc et grandissent dans un terroir dont la parfaite « tempérance » conditionne le raffinement des organes de la voix, l’abondance des voyelles, la beauté de la langue et celle de la pensée qui lui fait suite ; car plus l’air est pur et léger, plus les têtes sont raffinées ; Cicéron l’avait déjà déclamé sous le ciel de Rome…
Par conséquent, en dépit du despotisme ottoman, la Grèce demeure au XVIIIème siècle, Winckelmann en est convaincu, la terre bénie de la belle corporéité, de la liberté première, du beau sitôt absolu et de l’art tel qu’en lui-même.
Pour entendre ce qu’«archaïsme» va signifier dans le champ de l’anthropologie, en 1952, et dans la vision des Grecs qu’en auront les contemporains de Lévi-Strauss, il convient de passer, cette fois, par le cercle de L’Athenaeum, « l’Athénée », dans l’Allemagne du début du XIXème siècle ; c’est là que se découvre une idéalité de la mythologie, consubstantielle à la Grèce d’Europe, comme l’art est consubstantiel à la religion : mythologie, art, religion sans solution de continuité ; l’amour du grec en France (comme en Allemagne, mais avec un siècle d’écart) ne peut s’apprécier sans reconnaître le fondement philosophique que lui assure Hegel et sa Phénoménologie de l’esprit, une pensée si germanique aux yeux des Français, des gens de France : peuple frivole, dit Hegel, que toute son histoire condamne à l’ignorance, confine dans la méconnaissance des Grecs ; Winckelmann d’ailleurs y avait insisté, plus d’une fois, et, dans le fond, à bon escient….
Schlegel, Novalis, Schelling, Hölderlin, tous partagent la même vision de la mythologie. Et pour eux la chose, comme le mot, est seulement grecque. La mythologie surgit dans la grécité authentique du plus profond de l’esprit, elle est connaturelle au langage, elle apparaît en gloire : la mythologie, c’est une œuvre d’art de la nature, avec une part orgiaque, le feu de l’enthousiasme, l’enthousiasmos, au cœur de la sérénité grecque—cela prépare l’arrivée d’Apollon, depuis son Belvédère.
Les Grecs de l’archaïsme sont entrés désormais sur une scène où ils vont commencer à jouer la pièce dont l’intrigue va nous retenir davantage, car je m’intéresse à la manière dont un philosophe, qui va enseigner la sociologie, découvre qu’il y a des «peuples primitifs» et que l’archaïsme est une donnée fondamentale, probablement stable. Il y a beaucoup de courts-circuits épistémologiques dans ces voyages…
Avant que Winckelmann ne commence à tracer le premier sillon romantique de la Germanie, deux Européens, écrivant et parlant la français – qui est la langue des XVIIème/XVIIIème siècles – entreprennent de mettre en parallèle – de « comparer » – les fables, les récits ainsi que les coutumes des anciens de Plutarque, avec ceux des sauvages américains du Nouveau Monde. Ces deux Européens travaillent en même temps et publient en 1624, la même année – sans le savoir l’un l’autre, bien sûr-, des ouvrages gémellaires. L’un est un Académicien, et même un Académicien de l’espèce perpétuelle, Fontenelle, l’autre Jésuite, un Jésuite de terrain, en quête d’âmes à sauver, comme il convient.
Fontenelle, comme les philosophes de ses amis, ne voit dans les religions et autres croyances que des chimères, les rêveries d’esprits infantiles ; à l’inverse, le Père Latifau, de la Compagnie de Jésus, s’attache à montrer avec ferveur, à démontrer même, une étrange « conformité », comme il dit, des mœurs et des coutumes entre les sauvages et les anciens, Grecs et Latins, et tente de découvrir, en deçà de récits souvent obscènes et scandaleux de nos Grecs et de nos Romains, une religion sainte, une religion d’avant le christianisme, qu’il baptise adamique – d’après le vieil Adam. Celle-ci, religion de la première gentilité, aurait été commune à l’Ancien et au Nouveau Monde; il en relève les traces, il en montre les stigmates, dans les fables grossières et toujours ridicules des Grecs – c’est ainsi qu’on les juge alors – comme dans celles des Iroquois ou des Hurons de la Nouvelle-France. Mais l’homme des Lumières, et des plus vives Lumières, c’est Fontenelle ; il se montre curieux des étranges productions de l’esprit humain, il publie l’Origine des fables en même temps que Lafitau fait connaître ce livre qui s’appelle Les mœurs des sauvages amériquains comparées aux mœurs des premiers temps. Fontenelle, en philosophe de l’esprit, souhaite comprendre à quel état de pensée appartiennent les fables – on parle de fables à ce moment-là pour désigner les mythes grecs et romains – et, selon lui, de si vives ressemblances entre le nouveau et l’ancien monde ne peuvent s’expliquer que par l’existence d’un âge commun dans l’histoire de l’humanité. Les évidences de la comparaison, tirées de ressemblances immédiates, prouvent que l’humanité tout entière a connu en ses commencements une même ignorance et qu’en cherchant à rendre compte des phénomènes et du monde, cette première humanité a inventé la magie et les fables, des fictions pleines de prodiges et de sottises infantiles, comme il arrive aux enfants, avant qu’ils n’atteignent l’âge de raison ; la Théogonie d’Hésiode, qui raconte si crûment l’émasculation du Ciel par un fils pervers, n’est pas à lire comme l’hiéroglyphe mystérieux d’une première religion, ainsi que le pensait Lafitau, c’est tout simplement le témoignage direct que Grecs et Iroquois, aussi barbares et stupides les uns que les autres, ont partagé le même état de développement de l’esprit humain ; d’autres, un siècle et demi plus tard, appelleront cela l’âge mytho-poïétique, à la manière de Max Müller, qui , lui, élabore, à partir d’une linguistique alors si neuve, en indo-aryen comme on dit alors, une première mythologie comparée, contemporaine du premier Dumézil… Le comparatisme mythologique (qui sera, bien sûr, vite répudié par les uns, oublié par les autres) va prendre forme là, entre Max Müller, Lang et quelques autres au moment où Claude Lévi-Strauss, à peine agrégé de philosophie, s’en va benoîtement enseigner la sociologie de Durkheim aux Brésiliens….
Avant de découvrir avec Lévi-Strauss, les restes de quelques Indiens Nambikwara, dont il ignorait l’existence en prenant le bateau, un autre point de repère: dix ans auparavant, un marginal de la linguistique et de l’histoire des religions – Georges Dumézil – s’était embarqué pour la Turquie – celle d’Atatürk- où il sera le premier professeur d’une histoire des « religions comparées » qui doit contribuer à séculariser et à moderniser un morceau d’Anatolie et une vaste province de l’Islam. Il y a passé quatre ou cinq ans et accompli un important travail sur les langues caucasiennes, pendant ses vacances – en lieu et place du Nambikwara: les langues caucasiennes… Les vies parallèles ne sont cependant pas à mon programme, qui se donne plutôt comme visée de mettre en perspective les pratiques de l’un et l’autre. Cela constituera un chapitre d’une entreprise que je conduis ailleurs afin de comparer les comparatismes en leurs pratiques et modélisations.
En quoi Américains et Grecs sont-ils comparables – ou incomparables aussi bien -, dans les alentours d’une pensée «primitive», «sauvage», «mythique»? Voilà donc la question que j’entends explorer après l’avoir rapidement cernée du haut de mon observatoire nanti de ses deux siècles de profondeur, pas plus…
Les Grecs conçus comme une totalité, toujours. J’y insiste parce que, c’est pour moi, un point important : une totalité si meurtrière, en Occident, puisqu’ils n’en finissent pas de provoquer, tantôt des catastrophes intellectuelles et politiques—pensez aux Grecs de Heidegger et des Nazis—tantôt de profonds malentendus singulièrement autour du mythe, au temps où un agrégé de philosophie découvrait dans un pays lointain, en amateur, en touriste, l’ethnographie sinon l’ethnologie, ensuite, plus tard, les travaux de l’anthropologie sociale et culturelle,dans une Amérique anglo-saxone qui était à pied d’œuvre depuis déjà un siècle, et dont les ouvrages, totalement ignorés en France (sauf par de rares lecteurs, comme Mauss qui rendait compte de tout dans «l’année sociologique») gravitaient autour de Tylor et Boas et fondaient une Anthropologie générale et comparée.
Lévi-Strauss ne s’intéressera pas, semble-t-il, aux approches comparatives des Anglais, les Anglais qui avaient ouvert le champ de recherche Anthropology and the Classics; ils lisaient tous du grec, ils parlaient grec, ils sortaient de Cambridge et d’Oxford. On comprend déjà que pour Lévi-Strauss, par son éducation et sa formation (il a raconté de quel milieu il était issu, les filières qu’il a suivies : philosophie, droit…), les Grecs ne sont pas comme les autres: il hérite de certains Grecs ; forcément, pour faire de la philosophie, il faut un peu de grec comme chacun le sait. Ces Grecs-là, les Grecs de collège, Lévi-Strauss s’empresse de les congédier d’un geste anecdotique, en forme de carte postale—il y est souvent revenu notamment, dans Tristes tropiques, ouvrage écrit après coup. La carte postale porte ceci : «Athènes, l’Acropole, adieu! Nulle prière pour Athéna», une Athéna licenciée, comme l’«anémique déesse», «institutrice d’une civilisation claquemurée». En tournant également le dos à cette Grèce de collège et d’humanité classique, André Breton trouvera une meilleure formule, il parlera des Grecs et des Romains comme de nos «occupants de toujours»—«nos occupants », voilà qui sonne juste! Plus tard, dans sa maturité, dans les années cinquante, grâce à des questions venues de l’UNESCO – c’est l’UNESCO qui ouvre la fenêtre – sur «humanisme et humanités», Lévi-Strauss, avec la même condescendance dont il usera plus tard envers les historiens, se plaira à reconnaître une première forme d’ethnologie dans la pratique du grec et du latin…sous la férule des Jésuites de la Renaissance! Il est plaisant de lire l’éloge que fait Lévi-Strauss de la pédagogie des disciples de Loyola, quand il défend l’apprentissage du grec et du latin (en 1956 donc, texte repris dans Anthropologie structurale II, pp.319-320), et, ce, en des termes si traditionnels, puisqu’il écrit : «à travers la langue et le texte, l’élève s’initie à une méthode intellectuelle qui est celle même de l’ethnographie et que j’appellerais volontiers la technique du dépaysement …». S’il avait feuilleté les recueils de textes prolixes rédigés, par les pères de la Compagnie de Jésus, Lévi-Strauss aurait pu noter qu’une des instructions fondamentales de la mission confiée aux soldats du Pape était, je cite l’un d’eux: «étudier l’Antiquité comme une histoire du christianisme». Le précepte est répété de bulle pontificale en bulle très catholique, depuis les injonctions du fondateur de l’ordre, Ignace de Loyola.
Entre disciplines, les courts-circuits sont toujours intéressants (j’entends court-circuit dans le sens d’une voie plus courte que la normale). Le suivant se produit dans les années 60, dans le milieu des Hautes Etudes (Advanced Studies, dit-on aux USA ) au temps où les «Sciences religieuses» partageaient le même palier que la sixième section «Sciences sociales et économiques» ouverte, rouverte plutôt, par Fernand Braudel. Du côté des sciences dites religieuses, dans la lignée de Marcel Mauss, le solitaire, Lévi-Strauss a engagé des analyses structurales de mythes, selon le modèle linguistique proposé en 1955 (Anthropologie structurale I) et dont Œdipe, le malheureux Œdipe, avait dû faire les frais, en premier, ce qui n’est pas sans effet jusqu’à maintenant. Jean-Pierre Vernant à peine élu dans la section fondée par Braudel, publie deux ans après l’Anthropologie structurale, en 1960, un essai d’analyse structurale du mythe hésiodique des races – Hésiode le «théologien» de la Grèce – et il s’inspire explicitement d’un philosophe, un historien de la philosophie grecque, Victor Goldschmidt, lecteur de Dumézil et soucieux de comprendre comment s’articulent «genèse et structure» dans des récits très…philosophiques; Vernant conduira son analyse en regard du schéma de la tripartition fonctionnelle – cette structure tripartite, mise en chantier par l’indo-européaniste Dumézil et qui ne doit rien au modèle linguistique, phonologique, que Lévi-Strauss empruntera à Jacobson, aux Etats-Unis, avant de regagner la France en 1949…Tout ne va pas en ligne droite, loin de là. En 1963 et 1964, date du premier volume des Mythologiques, les passeurs sont en activité, et j’en suis, avec Lucien Sebag et deux ou trois africanistes, dont Pierre Smith était le plus vif. Du côté qui est le nôtre—hellénistes en «sciences sociales» puisque nous travaillions «chez Braudel»— nous découvrons combien l’ethnographie d’une société peut enrichir l’analyse de mythes qui laissaient souvent les classicistes fort indifférents ; quant à Lévi-Strauss qui s’est lancé dans l’aventure des Mythologiques, il va se mettre à parler grec, sans le savoir, au point de buter à son tour sur le «miracle» grec. Ainsi, dans le finale Du miel aux cendres, pp.407-408, où les Grecs surgissent soudain, comme par miracle ! Par quel chemin sont-ils arrivés là ?
Depuis longtemps archaïsme et peuples «primitifs» voyagent de conserve—jusqu’à l’embranchement de l’écriture, c’est-à-dire de la pragmatique de l’écrit. Dans la chaire de Mauss et de Leenhardt—ce dernier, missionnaire, océaniste—il était d’usage d’appeler «peuples non civilisés» les sauvages et les primitifs et dès son arrivée ( en fait trois ans après son sélection), Lévi-Strauss, convaincu, par son terrain et davantage encore par ses lectures, que l’ethnologie n’est nullement chargée de révéler le primitif derrière le civilisé, propose de modifier son intitulé de direction d’études (le titulaire est libre de le faire) en «religions comparées des peuples sans écriture» au lieu de «non civilisés», un «sans écriture», affirmant du même coup l’importance de la tradition orale, une tradition qui, va-t-il écrire, doit rester orale, au cœur de la pensée mythique et sauvage—sauvage et mythique. Insensiblement, au fur et à mesure de ses avancées en mythologie comparée (elles durent une dizaine d’années), Lévi-Strauss persuade son auditoire du caractère universel du mythe et de l’objet «mythologie», et il le fait en répétant notamment ce qu’il écrivait déjà en 1955, sans que nul s’en étonne, je le cite : «Un mythe est perçu comme mythe par tout lecteur—je souligne «lecteur» – dans le monde entier ». Le monde est une immense bibliothèque, remplie de lecteurs! Alors que Lévi-Bruhl, le philosophe de la «mentalité primitive » en Sorbonne dans les années 30, prenait soin, lui, de prévenir les étudiants que, dans les sociétés dites inférieures, les homes—les sauvages ou les primitifs—entendent des histoires, des proverbes, des paroles en intrigues, tandis que nous, nous les lisons. Lévi-Strauss n’aurait-il pas lu Lévy-Bruhl ? Lire, écrire : d’évidence, si la mythologie est chose à lire, c’est qu’elle existe d’abord en livres et qu’elle s’impose en pseudo-universel dans la langue qui la parle, la norme et lui donne forme en Occident. Cette langue, chacun le sait, c’est le grec…Mûthos est un mot grec. «Sans le savoir», Lévi-Strauss parlait et pensait grec comme tous ceux et toutes celles qui avaient été éduqués sous le régime des humanités qui, de la communale à l’université, nous apprenaient d’une voix, d’une seule voix, paternelle, à peine autoritaire, notre histoire qui commence avec les Grecs…
En France surtout, depuis les années 80 du XIXème siècle et jusqu’à hier, car, c’était l’une des évidences que susurrait le petit Lavisse, lequel n’a été remplacé qu’en 1970 ; de sorte que nombre de ceux qui ont détenu le pouvoir politique ces temps derniers, ministres et hauts fonctionnaires, avaient appris l’histoire dans leur petit Lavisse.
En 1970 donc, informé de nos travaux sur la pensée mythique et sociale des Grecs, Lévi-Strauss nous invite, Jean-Pierre Vernant, moi-même et Pierre Vidal-Naquet, à présenter à son séminaire du Collège de France les résultats de nos enquêtes, parfois parallèles, souvent conjointes quand il s’agit de Vernant et moi; il salue et commente à cette occasion de si heureuses convergences….J’ai gardé un souvenir précis de cette séance ; Lévi-Strauss a tenu à faire observer que l’ethnologie ne doit pas seulement constater qu’elle se trouve en présence de formes communes à des cultures antiques et à d’autres improprement appelées primitives. Il y a davantage. Je le cite: «Les anciens Grecs semblent avoir perçu et pensé leur mythologie dans les termes d’une problématique qui n’est pas sans analogie avec celle qu’utilisent aujourd’hui les ethnologues pour dégager l’esprit de la signification des mythes des peuples sans écriture». Pour le dire autrement, Lévi-Strauss entendait de nous faire voir que le mythologue de type hésiodique était le vrai jumeau du philosophe archaïque – dit «présocratique» – pensant la dualité du sec et de l’humide, la complémentarité du haut et du bas, de la même manière que la relation entre l’être et le non-être; il devait l’écrire un peu plus tard encore plus clairement et je le cite à nouveau: «Les Grecs faisaient déjà d’eux-mêmes l’analyse structurale de leur mythologie; le travail que l’analyse accomplit sur les mythes sauvages apparaît à fleur de peau, si je puis dire, dans les mythes grecs» . Singulier constat! Voici donc les Grecs devenus ethnologues, émules et précurseurs de l’anthropologie structurale. Ces Grecs-là, Lévi-Strauss les a fait surgir devant des hellénistes – ce que nous étions alors – surpris et qui sont restés muets, comme abasourdis par l’honneur rendu à une civilisation dont notre volonté de l’analyser de l’extérieur ne nous avait pas encore détachés autant que nous le pensions. Stupeur donc pour ceux qui avançaient dans le gué entre le mythe et la raison, stupéfaction de voir un anthropologue philosophe découvrant dans «leur Grèce» le lieu privilégié, unique, d’une pensée mythique se dépassant (comme il allait encore l’écrire) elle-même, accédant, par ses seules forces, à une logique de formes, au moyen de laquelle l’homme grec, nanti du concept, entreprend de penser sa propre mythologie, d’une part, et, de l’autre, fait émerger la pensée philosophique, dont la rigueur logique et conceptuelle inaugure les vertus de la science. Il faut ajouter que ces réflexions , Lévi-Strauss les a écrites en rendant compte, longuement et fort aimablement, d’un livre intitulé Les jardins d’Adonis, que je venais de publier en pratiquant l’analyse structurale, que j’avais apprise dans les Mythologiques et surtout dans «La geste d’Asdiwal». Mais trois ans plus tard, délaissant la mythologie du miel de l’Ancien Monde (que j’avais construite avec celle des aromates), je m’exerçais à comprendre comment avait eu lieu l’invention de la mythologie, entre les Grecs et nous—nous qui avions été si facilement convaincus qu’«un mythe est perçu comme mythe par tout lecteur dans le monde entier» et que, les mêmes « lecteurs » devaient en être assurés d’emblée: la philosophie était née une fois pour toutes en Grèce, seulement! Que les Grecs soient devenus en quelques années le paradigme de l’analyse structurale ne nous avait pas inquiétés intellectuellement; nous étions, il faut l’avouer, subjugués par les codes et le jeu des transformations qui nous était fort heureusement révélé dans la torpeur des monographies historiques dont la seule audace était de suggérer une origine proche-orientale ou le parallélisme avec une version hittite. Nous admirions, souvent bouche bée, l’exploit de celui qui démontrait, disait-il, la puissance et la rigueur logique d’un code astronomique, reliant Ancien et Nouveau Monde, sans avoir besoin de postuler des contacts historiques entre l’un et l’autre. Ce code astronomique – écrivait Lévi-Strauss – assujettissait la pensée mythique à des contraintes si strictes que, sur un plan purement formel, on pouvait comprendre que des mythes de l’Ancien et du Nouveau Monde dussent selon le cas se reproduire les uns les autres, sous une forme droite ou…inversée; il aimait beaucoup cette expression: forme droite et forme inversée, sans que l’on précise ce qui était droit et ce qui était inversé (on se reportera à Du miel aux cendres, p.63). C’est dans ce contexte que les Grecs sont entrés en activité en m’incitant à regarder la mythologie du miel des Anciens par rapport à celle des autres. En relisant aujourd’hui l’annonce d’aussi exaltantes perspectives, je me souviens avec quelle ardeur je rassemblais mythes d’Orion, des Pléiades, les informations autour de la bougonie, l’invention du miel – entre Dionysos, Déméter et Aristée; par lettres, Lévi-Strauss m’encourageait dans cette entreprise, une entreprise dont la vanité ne m’est apparue que peu à peu: en m’interrogeant sur la nature de ce que Lévi-Strauss appelait «mythème», et en me demandant si contribuer à faire la grammaire d’une langue ou d’un langage aussi peu crédible devait vraiment me motiver davantage. La pensée mythique emportée par le Linguistic turn, était sur le point d’imploser : comment croire encore que le mythe était langage, qu’il relevait d’une pensée analogique universelle ? Le mythe aura même, on le sait, sa formule magique, son algorithme, et l’on verra des logiciens s’exercer à le déployer sous les yeux des badauds. Alors que pour tout lecteur—et j’oubliais «dans le monde entier»—, ce mythe là, avec ses mythologies qui s’écrivent, était fait de mille et un matériaux des plus interlopes, sans cesse malaxés, triturés et qui parfois avaient été transmis assez mystérieusement avant de prendre la forme d’un récit «inoubliable». Il s’agissait donc le plus souvent d’une sorte de conglomérat hétéroclite, fait de restes, de résidus, de toutes sortes de productions symboliques ou imaginaires. Lévi-Strauss aurait pu s’en convaincre lorsqu’il consultait les encyclopédies bororos composées par les Franciscains: les mythes—ce qu’il appelait les mythes—sont cousus de mille et une choses: une citation, des commentaires, des ajouts, des proverbes… Adieu, sans regret, au mirage d’une pensée mythique et sauvage où les mythes se parlent entre eux et nous découvrent une imagerie mentale qui serait encore la nôtre, adieu aux mythèmes qui se voulaient d’autres phonèmes – séduction de Jacobson!
Tout n’est pas perdu pour autant des nombreuses expérimentations faites par Lévi-Strauss – excellent expérimentateur – parmi d’étranges récits et d’insolites croyances: il reste en effet des opérations conceptuelles utiles entre «La geste d’Asdiwal» et l’un de ses derniers livres, si riche, La potière jalouse. Relations et transformations, replacées dans le contexte ethnographique, ces opérations ont peut-être une valeur heuristique pour analyser certains récits attribuables à des traditions d’oralité, de mémoire partagée.
Relations d’abord: car la première hypothèse pose que les termes considérés isolément ne sont jamais porteurs d’un sens intrinsèque. Le sens découle de la manière dont ils s’opposent entre eux, il est de relation; transformations ensuite: analyser un de ces récits appelés «mythes», c’est étudier les rapports de transformation entre les versions de ce récit et des récits apparentés—ce qui veut dire que ni une seule version, ni une synthèse de plusieurs versions ne constitue un objet d’étude adéquat; enfin contexte: ce type d’analyse requiert la connaissance du contexte ethnographique ; un contexte ethnographique indépendant de la matière même du ou des récits, un contexte ouvert à l’ensemble des objets, des valeurs, des institutions qui constituent la culture de la société dans laquelle se racontent et circulent les récits choisis par l’analyste ; plantes, animaux, pratiques sociales , données géographiques, système écologique, phénomène astronomiques et techniques : autant de connaissances que doit posséder le lecteur-déchiffreur de tels récits, à la manière d’un encyclopédiste du vécu, car il s’agit bien de repérer, sous des détails, tantôt curieux, tantôt à peine perceptibles, la multiplicité des plans de signification qui donnent à ces récits leur épaisseur, leur consistance parfois si singulière.
Désormais, se donner l’illusion d’une pensée mythique déterminée par les règles inconscientes d’«un autre langage», convenons-en, c’est malaisé. L’analyse des récits traditionnels peut faire mieux, en expérimentant des structures conceptuelles dans des combinaisons tantôt locales, tantôt plus larges. Et grâce à la connaissance accrue d’un concret indigène, native, elle travaille sur plusieurs plans de signification, afin d’extraire de chaque domaine d’expérience certaines propriétés latentes. C’est une procédure qui, me semble-t-il, enrichit les récits en faisant découvrir davantage de différences, de distinctions possibles qui complexifient la culture choisie et la dotent d’un ensemble inédit de relations qualitativement différentes…
Les ethnologues qui pensent en anthropologues ne sont pas les plus nombreux, au pays de la rareté. Certains d’entre eux—qui ne se contentent pas de comparer la fourchette des Windsor et les baguettes d’Hiroshima ou les inversions en forme de scoops—savent pertinemment que «qualifier» quoi que ce soit sur un «terrain», dans une culture «autre», c’est le «traduire» par le truchement de catégories qui, en principe, doivent permettre la comparaison avec d’autres expériences culturelles dont les nôtres ne sont pas les moindres.
«Royauté sacrée», «sacrifice», «initiation» sont des catégories qui semblent aussi évidemment universelles que «religion» ou «mythologie». C’est en travaillant-conversant avec des anthropologues critiques comme Dan Sperber et Pierre Smith, dans les années où, parmi les «sociétés anciennes comparées», l’on se préparait à rentrer au village que «repenser la mythologie» dans un volume sur la «fonction symbolique» (1979) m’a conduit à suivre, en quelques étapes, comment s’inventait «la mythologie». Enquête mal reçue dans le quartier structural, mais où les Grecs d’Amazonie n’avaient pas encore été «exhibés». C’est chose faite, et, en bonne critique, je l’espère.