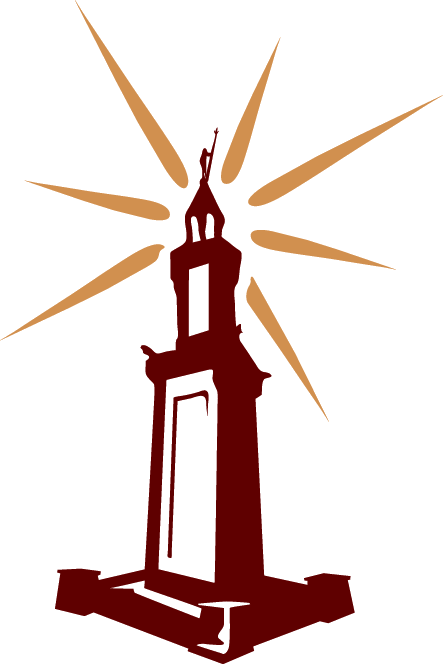Pierre Judet de La Combe, EHESS, CNRS
Ma dette envers Gregory Nagy est immense. Issue d’une tradition herméneutique littéraire lointainement rattachée à la réflexion théorique de Friedrich D. E. Schleiermacher, puis refondée par Peter Szondi et surtout par Jean Bollack, la philologie que je pratique est avant tout attentive à la compréhension des œuvres de langage comme individualités historiques et comme événements potentiellement critiques au sein de leur propre milieu de genèse. Centrée sur les œuvres, elle ne pouvait qu’être provoquée, stimulée, enrichie et profondément transformée par sa rencontre avec une herméneutique neuve et rigoureuse des traditions poétiques. Et de fait, la rencontre de Greg en 1977, puis les longs et profonds échanges que nous avons eus tous les ans au sein du séminaire CorHaLi (Cornell-Harvard-Lille) [1] ont été décisifs, car ils m’ont constamment obligé à référer l’hypothèse du sens, comme cadre nécessaire de la lecture, à la prise en compte de la matérialité de ce sens comme réalité langagière. Greg a profondément renouvelé les notions avec lesquelles travaille la philologie, celles de langue, de texte, de tradition. La langue, contrairement à ce que tend à poser l’herméneutique traditionnelle, centrée sur une idée réifiée de l’auteur, n’est pas un simple moyen expressif mis à la disposition d’un projet signifiant, d’une intention, mais, comme le rappellent tous les travaux de Greg, non seulement a ses contraintes propres, en tant que système, mais surtout conditionne toute expression historique en ce qu’elle rend possible l’élaboration des contenus signifiés, qui n’existeraient tout simplement pas sans elle. Elle devient par là tradition, histoire.
L’une des grandes avancées accomplies par le travail de Greg est, déjà pour Homère, d’être sorti d’un double mécanicisme : celui qui a été un temps scientifiquement le plus fécond, d’une approche qui renvoyait mécaniquement les actes de langage constitutifs de l’épopée à une situation première de composition orale conçue de manière abstraite et encore romantique, dans une relation supposée immédiate et harmonieuse entre l’aède, sa langue et les attentes de son public, comme si une tradition singulière, celle d’« Homère », n’avait pas pris corps dans le temps, comme si la succession des performances n’était pas cumulative et productive et ne transformait pas ce qui était récité ; et celui, plus ancien et plus naïf, qui référait mécaniquement les états de la langue à une époque ou à des poètes différents, selon la perspective de l’Analyse.
Dans l’œuvre de Greg, l’unité de base, avec ses mouvances et ses contradictions internes, n’est plus celle d’un texte ou de ses parties, ni l’atome originel d’une performance, mais le long travail historique d’une élaboration poétique et culturelle qui n’est intelligible que si l’on tient compte des différentes dimensions du langage, comme milieu où se schématisent, c’est-à-dire se proposent à la communication et à la reconnaissance, des expériences sociales et des attentes chaque fois situées. Comme en témoignent maintenant les deux grands livres jumeaux, Homer the Classic et Homer the Preclassic, la langue n’est pas réifiée à son tour (comme l’avait été l’auteur par la philologie) ; elle n’est pas le milieu indépassable qui renverrait toute expression aux immaîtrisables mécanismes de la signifiance. Elle est productivité historique. Une nouvelle herméneutique, qui a la tradition comme objet, est ainsi mise en place.
Le défi est énorme pour une philologie qui, malgré tout, tient à l’idée d’une unité de sens propre à un texte, serait-ce l’Iliade. Comment peut-elle ne pas retomber dans le « textualisme », souvent dénoncé par Greg, c’est-à-dire dans l’illusion que la simple co-présence observable au sein d’un même ensemble textuel d’éléments différents mais à l’évidence reliés entre eux d’une manière ou d’une autre, est la garantie que cette œuvre peut faire sens ? Cette illusion s’appuie sur l’idée technicienne d’un démiurge qui aurait su organiser cette diversité en vue d’une fin qu’il se serait fixée au préalable. Or un tel démiurge est historiquement introuvable pour « Homère ». Si la méthode herméneutique (au sens scientifique, et non philosophique du terme) exige bien que l’ensemble des traits signifiants d’un texte soient relevés et pris en compte, et surtout que soit pris en compte l’ordre temporel dans lequel ils apparaissent au cours du texte, c’est-à-dire leur liaison – sinon la démarche reste partielle et arbitraire –, on ne peut déduire de ce réquisit méthodique, qui vaut pour n’importe quel texte, l’Iliade ou une ode de Pindare ou un code de lois, une thèse sur l’essence du texte, à savoir sur sa raison d’être dans l’histoire. Il y aurait là un saut, un passage illégitime de la méthode à la détermination d’un être historique. Le postulat herméneutique, tenable jusqu’à la démonstration du contraire, d’une cohérence dans l’organisation des éléments textuels au sein d’une œuvre n’implique pas l’existence d’une instance souveraine réelle, un auteur, qui aurait su réaliser cette organisation. Les modes de composition d’une unité signifiante organisée jusqu’au raffinement, comme cela semble bien être le cas pour les poèmes homériques, peuvent être divers, et l’intervention d’un auteur n’est que l’un d’entre eux.
Si une herméneutique d’un texte comme l’Iliade est encore possible, elle doit tenir compte de ce que l’on sait maintenant de la variance qui caractérise la tradition de ce texte, de la diversité des attentes qui ont déterminé ses solidifications successives dans les diverses cultures qui ont constitué la « Grèce » archaïque, classique et même hellénistique. Par rapport à une herméneutique de la tradition, qui reconstruit l’histoire de ces attentes et ses effets sur l’évolution du corpus textuel, l’accent, dans une herméneutique du texte, sera simplement déplacé. Par hypothèse, il sera posé qu’un principe d’unification, mais aussi de changements internes possibles, peut être trouvé dans le thème du poème, dans le cas de l’Iliade : « la colère d’Achille ». Cela suppose que ce thème ne soit pas pris comme un simple objet narratif, comme un simple morceau de la tradition héroïque, mais que, de manière dynamique, il soit conçu comme une question, comme le support limité et bien défini de demandes successives adressées à la tradition dans son ensemble, traditions narratives, mais aussi culturelles en général. Dès Le Meilleur des Achéens, Greg nous a appris qu’un thème, en ce qu’il motive des performances, doit être compris de manière non restreinte, qu’un même thème peut être réalisé ou ponctuellement dans une formule, ou, plus largement, dans un épisode ou même dans un poème entier. Le thème encadre le sens, il le définit. Il n’est pas un simple objet. L’hypothèse sera ici que le thème traditionnel est en lui-même porteur de réflexion, et qu’il est de ce fait le moteur d’un travail historique sur les données que le poème intègre, données extérieures, tirées du mythe, des croyances, des pratiques religieuses, politiques et poétiques, et données tirées de l’œuvre elle-même quand, dans son histoire, l’Iliade est amenée à reconsidérer son propre passé, ses formes antérieures.
Pour définir la tradition homérique, Greg emploie souvent la métaphore du « flux », du fleuve qui passe par différents contextes et qui se recompose par ces passages. L’accent sera mis ici sur ce qui donne une forme à ce flux, une direction. Pour reprendre l’analyse du fleuve selon Héraclite, on privilégiera l’immobilité des rives qui délimitent constamment cette mobilité et qui en sont même la condition. Sans elles, sans la pression qu’elles exercent, le fleuve deviendrait inerte [2] . Cette fixité des « rives » est aussi transmise, elle fait aussi la tradition. Dans le cas de l’Iliade, elles n’ont visiblement jamais été bougées ou transgressées. Ce sont les bornes narratives que le poème s’est données. Apparemment, il s’en tient toujours à ces limites, à savoir aux cinquante-deux jours, sur les dix années de la guerre de Troie, qu’il choisit de raconter. N’y figurent jamais la mort d’Achille (qui aurait pourtant sans doute été un épisode nécessaire si le poème avait comme objet poétique et rituel premier la « gloire » d’Achille et son culte), ni la prise de Troie, même si la mort d’Hector la rend inévitable. On ne trouve que le déroulement de la colère d’Achille, en ses deux étapes : avec le retrait du héros puis son retour, dû à la catastrophe, au sens de renversement, qu’est la mort de Patrocle provoquée par le retrait. Rien de plus, même si les autres épisodes de la geste troyenne sont présents dans le poème, par récits, par déplacements narratifs, comme sont indirectement présents la geste divine et le terme absolu qu’est la fin de la race des héros, comme Philippe Rousseau a su merveilleusement le montrer dans le détail d’une interprétation méthodique de l’ensemble du poème qui développe, sur un mode philologique démonstratif, une lecture « néo-unitarienne » extrêmement efficace et à laquelle je dois aussi beaucoup [3] . Pour la composition de l’Iliade, une limite narrative a été fixée une fois pour toutes, et on imagine mal qu’elle ne l’ait pas été dès l’origine, dans une décision qui a fait le thème, quels que soient les traitements qu’il ait connus, puisque est marquée avec ce thème l’identité d’une tradition. Cette restriction thématique est sans doute la condition du projet collectif d’une épopée monumentale, différente des autres épopées, qui étaient plus restreintes. La limite textuelle à la fois endigue et active le fleuve de la tradition. Paradoxalement, la limitation drastique du thème a fait le monument, son ampleur.
Dans les pages qui suivent [4] , je voudrais adresser à Greg une « question homérique » sur la nature de ce thème, sur ses potentialités. Pour la formuler de manière à la fois élémentaire et prétentieuse : de quoi parle l’Iliade ? Cette question ne peut trouver sa réponse par la seule observation, nécessaire, des éléments constitutifs du poème ; elle doit être doublée d’une autre : en quoi le thème choisi, la colère d’Achille, pouvait-il à ce point intéresser les cultures qui ont investi le poème qui raconte cette colère d’une telle valeur et d’une telle portée ? Qu’il me soit permis de formuler ici une hypothèse dans sa nudité, sans me référer directement à l’immensité des travaux connus. Une étude plus approfondie devra situer cette hypothèse par rapport aux lectures existantes.
La crise du chant I
L’Iliade est le récit d’une crise, dans le double sens du mot, tel que l’analyse du concept de crise par la sociologie contemporaine permet de le préciser (je me réfère ici à Jürgen Habermas) [5] . Pour qu’il y ait crise, c’est-à-dire un changement irréversible d’un état des choses, deux réalités complémentaires interfèrent. Elles sont à distinguer, puis à relier :
La question qui se pose à nous est alors elle-même double :
- – tout d’abord, il s’agit, par une analyse interne, de comprendre la nature de ces crises et de leurs relations : quelle règle sociale est mise à mal, et pour quelles raisons, avec quels enjeux ? Pourquoi cette crise sociale et politique est-elle liée à la prédominance, sans précédent, d’un affect individuel, la colère ? S’agit-il d’un dysfonctionnement accidentel, seulement dû à la nature exceptionnelle de son agent principal, Achille, et de ses adversaires, le roi Agamemnon, les chefs achéens, les chefs troyens, etc., ou l’analyse que développe le récit ne porte-t-elle pas sur un dysfonctionnement de principe, sur la nécessité de ces crises ? Et, au-delà : quel est le lien entre les crises humaines et la crise divine ?
- – mais en rester à ce point de vue, encore interne, est insuffisant. Il s’agit aussi d’interroger la relation entre les contenus individuels et sociaux, humains et divins, ainsi analysés par le récit et la forme donnée à cette analyse, à savoir un récit épique monumental. La forme narrative fait que les raisons et les enjeux de la crise ne sont pas développés et discutés abstraitement, dans une réflexion explicite sur les normes et leurs faiblesses, comme c’est le cas dans d’autres formes de discours, par exemple dans la poésie de réflexion politique, qui développe des arguments sur la valeur des systèmes normatifs et des comportements individuels (poésie postérieure aux premiers textes d’« Homère », comme chez Solon). Dans l’épopée, les raisons et ces enjeux généraux, humains et divins, apparaissent indirectement, à l’occasion de situations particulières, d’événements, où interfèrent actions et discours humains et interventions des dieux. Le caractère temporel du récit, d’épisode en épisode, avec des renversements de situation inattendus et paradoxaux (Achille ne combat plus ; les Achéens, à qui Zeus avait promis de prendre Troie, la ville fautive, sont d’abord vaincus et massacrés), fait que la signification des événements ne peut jamais être assurée une fois pour toutes, puisque les situations changent, et, notamment, que changent les instances qui sont censées guider et garantir le sens de ce qui a lieu, à savoir les dieux, qui sont eux-mêmes pris dans des conflits, et qui évoluent, comme on voit Zeus, au fil du récit, devenir de plus en plus tyrannique et semblable à son père déchu, Cronos, dans sa relation avec les autres divinités de l’Olympe.
On ne peut donc dire qu’un « monde » préétabli, stable, s’expose au moyen des événements racontés qui ne feraient qu’en illustrer la composition ou même la complexité [6] . Ce monde est lui-même, par le récit, soumis à une dynamique de transformation et ne dévoile son sens que par ces transformations. Sa cohérence, si on en présuppose une, ce qui semble requis, n’est pas donnée au départ, elle n’est pas résumable, réductible à quelques propositions fondamentales, comme ce sera le cas dans les systèmes philosophiques ultérieurs, ou dans la tragédie, mais résulte de la cohérence du récit, des limites qu’il fixe à sa matière et des règles qu’il se donne pour la développer. Le sens ne peut être détaché de la forme particulière qu’il prend, dans une forme poétique donnée. La forme est ainsi la garante de la cohérence des contenus représentés, même les plus universels, comme le pouvoir de Zeus sur les choses ; elle n’en est pas l’expression. Cela pose la question de fond d’une rationalité propre au récit épique comme mode de représentation, par rapport à d’autres formes, mythiques ou théoriques.
En effet, mythe et épopée (monumentale) doivent sans doute être distingués, au sens où la forme épique, c’est ici l’hypothèse, détermine l’interprétation qui peut être donnée du mythe dont elle fait son objet. Elle imprime un point de vue, et par là une interprétation. Le mythe, toujours réalisé dans des formes particulières, pouvait exister indépendamment de cette forme-là. Quant à la théorie (des philosophes), en tant qu’elle porte sur « ce qui est » en général, et non sur des événements singuliers, elle donne au récit qu’elle développe, dans les cosmogonies, une autre fonction, celle d’un dévoilement différé du sens des objets traités en tant qu’ils relèvent de principes ; ces principes sont eux-mêmes exposés aux début des systèmes. L’épopée héroïque n’a pas recours à cette forme double : position de principes, puis récits de leurs réalisation ; tout est contenu dans le récit, qui s’auto-interprète, selon les situations particulières et parfois contradictoires qu’il crée.
La forme épique monumentale
Avant de commencer à déchiffrer ces crises, quelques mots sur cette forme. Nous avons, avec l’Iliade, le premier texte connu de la tradition grecque. Il y a depuis la naissance de la philologie moderne, à la fin du XVIIIe siècle, un énorme débat sur la genèse de ce texte. La « question homérique », telle qu’elle a été formulée en Allemagne, est d’ailleurs le terrain où se sont mises en place les questions et les options générales propres de la science historique contemporaine. Ce débat critique a eu tendance à recouvrir la question de l’interprétation de ces textes, de leur signification et de leur portée et donc de la nature de l’intérêt que pouvait leur adresser les cultures qui ont présidé à leur formation et à leur diffusion.
Pour le problème qui nous intéresse ici, nous pouvons simplement rappeler que :
- – les deux grandes épopées, l’Iliade et l’Odyssée ont été précédées d’une abondante tradition épique (relative, entre autres, à la guerre de Troie : la guerre elle-même et son origine, le retour des Achéens chez eux), dont l’Iliade se distingue par son mode de composition, même si elle fait du contenu de ces traditions sa seule matière ;
- – avec l’Odyssée, il s’agit de la seule épopée monumentale connue. Monumentale par sa longueur et par les circonstances de sa récitation : non pas des poèmes isolés présentés devant des publics aristocratiques restreints (comme, sans doute, les récits antérieurs), mais des poèmes très longs, récités lors des festivals grandioses. Cette épopée monumentale ne constitue donc pas, à proprement parler, un genre, puisqu’elle n’était réalisée que par deux œuvres. Le nom d’« Homère » signifie sans doute la spécificité de ces poèmes ;
- – la composition initiale de ces épopées monumentales remonte sans doute au VIIIe siècle avant J.-C., époque où s’est mise en place une autre institution « panhellénique » de grand format, les Jeux Olympiques, et cela dans une société dont l’archéologie montre maintenant la complexité (société aristocratique, et non monarchique, construite selon des normes qui continueront à prévaloir dans les « cités »).
La forme épique monumentale se distingue, dès cette époque, de formes poétiques différentes déjà établies (et que les poèmes homériques mentionnent) : chants narratifs héroïques plus courts accompagnés de la lyre (cf. les chants de l’aède Démodocos au chant VIII de l’Odyssée, alors que l’épopée était récitée, et non chantée), poésie de sagesse sur la morale (voir la discussion entre Ulysse et les jeunes Phéaciens, toujours au chant VIII), poésie lyrique amoureuse (cf. Iliade I, 54), hymnes, etc. Il est donc erroné de reprendre l’idée traditionnelle d’une succession des « genres », épopée puis lyrisme comme formes poétiques et comme expressions de rapports au monde différents et successifs. Le récit de la fabrication du bouclier d’Achille, au chant XVIII, fait une large place, dans les scènes représentées, à la musique chorale et à la danse ; elle insiste même sur la proximité entre le caractère répétitif, cyclique, de cet art et la figuration plastique, qui, sur ce bouclier, ne représente pas des événements uniques, comme le fait l’épopée héroïque, mais des scènes typiques, amenées à se répéter. Dans cette objectivation de la figuration par images et de la lyrique, une forme d’art, l’épopée, à la fois interprète d’autres formes, s’en distingue et par là leur rend hommage, cela au moment même où elle prépare, avec la fabrication d’armes nouvelles et remarquables, le récit de l’exploit héroïque et absolument singulier d’Achille, la mise à mort d’Hector. On a déjà là l’indice d’un propos de l’épopée monumentale qui distingue cette poésie des autres : le projet d’intégrer dans un même poème la présentation de l’ensemble des pratiques symboliques qui, dans leurs contrastes et leur variété, font une culture.
L’une des formes avec lesquelles le contraste est le plus grand est l’épopée théologique, forme nettement plus brève qu’on trouve représentée par Hésiode, avec sa Théogonie, qui n’est qu’une parmi d’autres. Le vers, la plupart des mythes, la langue sont presque identiques, mais le propos est radicalement différent : la Théogonie, comme « mytho-logie », c’est-à-dire comme discours savant sur le mythe, reconstruit la cohérence de la tradition mythique par une réorganisation de type déductif (sur le modèle de la généalogie, qui établit des ordres naturels de préséance). Cette poésie pose tout d’abord des divinités primordiales inengendrées (Chaos, puis Terre et Éros chez Hésiode ; chez d’autres auteurs, implicitement discutés par la Théogonie, cela peut aussi être Nuit ou Océan, cf. le vers 20) pour reconstruire la logique de l’ensemble des récits connus. On est dans une démarche proche de celle des systèmes philosophiques des Présocratiques, avec un objet différent : le poème porte sur les dieux (c’est-à-dire sur leurs récits), qui gèrent la réalité des choses et non sur cette réalité elle-même, comme ce sera le cas chez les théoriciens de la nature. Mais le propos, à savoir une systématisation déductive des contenus, est le même. Le récit n’y a donc pas la même fonction que dans l’épopée monumentale : il déploie, dans toute sa complexité et ses potentialités, une structure de sens posée au départ avec les divinités fondamentales, et cherche par là à légitimer les récits traditionnels. C’est la perspective d’une « reconstruction » a posteriori de la logique interne au patrimoine traditionnel considéré dans ses variances, qu’il s’agit de rationaliser.
Forme épique et limitation du récit
Pour l’Iliade, le fait compositionnel majeur est, comme on l’a dit, que dans l’ensemble de la tradition sur la guerre de Troie, elle n’a « choisi » qu’une séquence très brève : cinquante-deux jours sur les dix années du conflit, et elle s’en tient rigoureusement là. Le poème ne traite que de la colère d’Achille (avec le désastre des Achéens qui en résulte, jusqu’à la mort de l’ami d’Achille, Patrocle), puis, après cette mort, de la transformation de la colère (mênis) en rage (menos) victorieuse contre les Troyens et contre le vainqueur de Patrocle, Hector. La mort d’Achille, plusieurs fois prophétisée, la ruine de Troie sont laissées à d’autres poèmes, de prestige moindre. Une tension peut alors être repérée entre l’étroitesse de la matière et l’universalité des questions abordées : il ne s’agit pas d’un simple segment narratif, mais d’une forme au sens où la seule colère d’Achille sert à réexposer l’ensemble des enjeux du conflit universel que fut, selon le mythe, la guerre de Troie. Cette colère précise, déterminée (celle d’Achille, et non d’un autre, dans cette circonstance), fonctionne comme un schème, c’est-à-dire comme un mode ouvert de représentation, pouvant accueillir et mettre en forme des matériaux divers.
L’épopée se propose par là, au moyen de ce schème ou thème unique, de donner le sens de tout ce que la tradition (et les autres formes de discours public, citées dans l’œuvre, poésie narrative, lyrique, réflexion éthique, discours sur les dieux, sur le droit, paroles rituelles, prophétiques, etc.) a pu dire en le concentrant sur la présentation de cet épisode restreint. Les origines de la guerre, ses conséquences, la mythologie sous-jacente, avec notamment la constitution du monde des dieux, du pouvoir de Zeus sur l’Olympe, n’entrent pas directement dans le récit, mais sont présents par une série de déplacements, de métaphores et de métonymies (dont l’ampleur et l’efficience comme mode compositionnel ont été découverts par Philippe Rousseau, dans une discussion avec la Néo-analyse de W. Kullmann, et avec la théorie de la composition orale, notamment chez Greg). Tout se joue hic et nunc, dans cette séquence étroite d’événements. L’histoire d’Achille se trouve reproduire, dans une condensation, ce qui a pu être développé avant, dans d’autres formes de récit et de discours.
Une hypothèse, dès lors, pourrait être que s’il y a eu coupure dans le développement culturel de la Grèce archaïque, ce fut moins au VIe siècle, avec l’apparition d’une culture présentée comme « rationnelle » (liée, dit-on souvent, à l’émergence des systèmes philosophiques, cela au moment où se serait constitué le cadre normatif des cités, ainsi chez Jean-Pierre Vernant), qu’aux VIIIe-VIIe siècles, avec l’apparition de la forme épique comme forme de systématisation du mythe, sous deux aspects différents : la forme monumentale, immanente, d’un récit s’auto-interprétant (« Homère »), et la forme déjà plus théorique d’un discours déductif, avec les théogonies (« Hésiode »). Il y a eu là un acte fondateur, désigné comme tel par la tradition ultérieure (cf. Hérodote, au livre II, sur l’origine des appellations des dieux, qu’il attribue à ces deux poètes).
Principe d’immanence
Pour prendre tout de suite un exemple du principe d’immanence propre à l’épopée homérique comme récit se donnant la limitation comme règle [7] : après le déclenchement de la crise, Achille, en pleurs, se trouve isolé. Il a renoncé au combat, parce qu’Agamemnon s’est, comme roi plus puissant, approprié sa prise de guerre, la captive Briséis. Agamemnon a « dû » le faire parce qu’il a été lui-même dépossédé de sa propre captive, la jeune Chryséis, qu’il a dû rendre, après l’épisode de la peste, à son père, prêtre d’Apollon. Agamemnon cède, mais se trouve alors sans prise de guerre, sans « part d’honneur », ce qu’il juge impossible. Pour se dédommager, il prend à Achille sa captive, car ce héros avait insisté pour qu’il livre Chryséis sans dédommagement immédiat. D’où la crise, d’où le retrait et les pleurs d’Achille. Le héros, seul au bord de la mer, appelle sa mère Thétis. Il lui raconte toute l’histoire et lui demande d’intervenir auprès de Zeus pour être vengé par le massacre des Achéens. Il rappelle à sa mère qu’elle a de bons arguments pour convaincre le dieu, car autrefois elle a aidé Zeus lors d’une révolte des dieux olympiens contre lui. Le mythe, brièvement rapporté, sert d’argument (chant I, 393-410) :
Mais toi, si tu le peux, protège ton fils valeureux,
En allant dans l’Olympe prier Zeus, s’il est vrai qu’autrefois,
395Ou en parole tu secourus le cœur de Zeus, ou en acte.
Car souvent dans le palais de mon père je t’ai entendue
Te vanter, quand tu disais que de Zeus aux noirs nuages,
Seule parmi les immortels, tu avais écarté l’ignoble destruction,
Quand les autres Olympiens avaient décidé de le lier,
400Héra, et Poséidon et Pallas Athéna.
Mais toi, tu vins à lui, déesse, et dénouas les liens,
Convoquant vite vers le grand Olympe le Cent-Bras
Que les dieux appellent Briarée et tous les hommes
Égéon, lui qui en force est meilleur que son père,
405Qui, rayonnant de gloire, s’assit près du fils de Cronos.
Les dieux bienheureux s’effrayèrent et ne le lièrent pas.
Faisant mémoire de cela, assieds-toi près de lui, prends ses genoux,
S’il décidait d’une manière ou autre de seconder les Troyens
Et les Achéens, de les rouler jusqu’aux poupes et au golfe de la mer,
410Massacrés…
En allant dans l’Olympe prier Zeus, s’il est vrai qu’autrefois,
395Ou en parole tu secourus le cœur de Zeus, ou en acte.
Car souvent dans le palais de mon père je t’ai entendue
Te vanter, quand tu disais que de Zeus aux noirs nuages,
Seule parmi les immortels, tu avais écarté l’ignoble destruction,
Quand les autres Olympiens avaient décidé de le lier,
400Héra, et Poséidon et Pallas Athéna.
Mais toi, tu vins à lui, déesse, et dénouas les liens,
Convoquant vite vers le grand Olympe le Cent-Bras
Que les dieux appellent Briarée et tous les hommes
Égéon, lui qui en force est meilleur que son père,
405Qui, rayonnant de gloire, s’assit près du fils de Cronos.
Les dieux bienheureux s’effrayèrent et ne le lièrent pas.
Faisant mémoire de cela, assieds-toi près de lui, prends ses genoux,
S’il décidait d’une manière ou autre de seconder les Troyens
Et les Achéens, de les rouler jusqu’aux poupes et au golfe de la mer,
410Massacrés…
Ce mythe d’une rébellion des dieux olympiens contre Zeus est parfaitement inconnu par ailleurs. Homère ne le développe pas, n’en précise ni les circonstances, ni l’enjeu, mais donne des indices sur la manière dont il faut l’interpréter. Le nom du sauveur, Briarée, dieu de violence, est dans la Théogonie d’Hésiode celui du dieu qui, avec ses frères, a aidé Zeus dans sa guerre contre la génération de ses parents, les Titans. Briarée, avec ses frères, lui a assuré la victoire et le pouvoir définitif sur l’Olympe. Le conflit mentionné ici reproduit cette guerre ; il s’agissait bien d’effacer la victoire ancienne de Zeus et de recommencer le cycle des révolutions divines. Par ailleurs, les trois divinités qui s’opposent à Zeus sont Héra, Poséidon et Athéna (selon Zénodote, Apollon remplaçait Athéna). Or ces trois dieux sont ceux qui soutiennent les Achéens. Ce sont eux qui vont s’opposer à la décision de Zeus de détruire les Achéens pour venger Achille [8] . Ils vont, à plusieurs reprises, se rebeller. Le conflit, raconté ici au passé, va en fait se reproduire dans l’Iliade. Enfin, Briarée est dit avoir une force supérieure à celle de son père. Or c’est exactement ce qui caractérise Achille, qui est plus fort que son père Pélée. Si ce mortel l’a engendré, c’est précisément parce que Zeus a renoncé à s’unir à Thétis, car il était prophétisé qu’elle aurait un fils plus fort que son père. Elle est alors, par Zeus, contrainte d’épouser un mortel.
Le mythe, raconté au passé, s’éclaire, s’interprète par ce qui va avoir lieu dans le poème. On apprend que Zeus remet en jeu son pouvoir en aidant Achille. La similitude entre Achille et Briarée, sauveur de Zeus, fournit un élément d’explication de cette solidarité inattendue (puisque Zeus avait promis de détruire Troie et les Troyens). Le mythe n’explique pas, il est expliqué par la suite du récit. Mais son rappel laconique est à prendre comme un indice, celui d’une modalité : ce qui va suivre a la même nécessité que le mythe raconté, mythe qui lui-même rappelle le combat de Zeus contre les Titans, combat qui fonde son pouvoir. Le récit épique se donne ainsi, par la recomposition seulement allusive d’un autre mythe, un cadre contraignant. Il reste à se demander pourquoi Thétis, l’une des nombreuses filles d’un dieu de la mer, a eu matériellement ce pouvoir autrefois : il y a là un univers de récits (avec un rôle primordial donné à la mer, comme puissance échappant à la stabilité et à la détermination, rôle dont témoignent les textes d’Hésiode et d’Alcman) sur lequel Homère n’insiste pas. Ce n’est pas son objet ; il n’est pas théologien.
Interpréter un tel poème revient, d’abord, à repérer les transformations que subissent les matériaux traditionnels pour entrer dans ce récit limité, puis à saisir les effets de sens que cette transformation produit et enfin, plus fondamentalement, pour expliquer l’existence d’une telle forme, à se demander à quel propos correspond une opération aussi complexe de composition. Par un renversement, l’action limitée qui est l’objet du poème devient le cadre où se réalisent, sur un mode déplacé, des éléments mythiques généraux : le mythe de Briarée sauvant Zeus, ou, au chant XXI, le mythe du cataclysme, qui se trouve réalisé de manière inattendue avec le massacre des Troyens dans le fleuve Scamandre par Achille et avec le déferlement massif des eaux de ce fleuve et de ceux de la Troade contre Achille, dans un épisode qui prend, pour une fois, une dimension cosmologique, avec la lutte du l’eau et du feu. Le texte homérique indique qu’il se réfère à ces traditions, mais qu’il en transforme le sens puisque au lieu de servir de cadre général, théogonique ou eschatologique, au récit raconté, ils mettent en valeur, de manière strictement immanente, l’action singulière du héros. L’épopée héroïque se présente par là comme forme auto-suffisante ; elle englobe les traditions des récits généraux sur l’histoire des dieux et des générations humaines (avec le cataclysme), et n’en dépend pas.
La réflexion comme tradition
Cette recomposition mythique singulière ne nous renvoie pas à l’éternelle question de l’auteur d’un tel poème. Si le cœur du texte est un point de vue sur la tradition narrative, et sur les autres formes de discours, et si ce point de vue est une question précise adressée au matériau existant à partir d’un thème donné et des potentialités symboliques d’une forme, il n’est pas besoin de supposer que derrière cette question il y a une subjectivité singulière « constituante » (subjectivité bien évidemment envisageable, contrairement à ce que l’on dit souvent, déjà à l’époque archaïque, même si elle n’est elle-même alors pas conceptuellement constituée ; elle peut être simplement opérante, sans être théorisée, être constituante sans être constituée). Selon le modèle herméneutique de l’auteur (représenté pour la question homérique tout autant par la tradition unitarienne, avec un seul auteur, que par celle des Analystes, avec plusieurs), cette subjectivité développerait librement son point de vue. Mais la question posée à la tradition, question qui prend la forme d’une réflexion se donnant un épisode précis, borné, la colère d’Achille, comme schème directeur dans le but d’une systématisation de ce qui a déjà été dit, peut elle-même être transmise comme tradition, mobilisant les efforts différents et éventuellement successifs de compositeurs. Les aèdes homériques puis les instances qui fixent le texte participent à cette entreprise de systématisation, sur la même base. Ce serait partir d’un concept trop court de la tradition que de supposer qu’elle est seulement une matière quasi inerte, objective, qui pourrait se trouver informée du dehors, de temps en temps et comme par miracle, par un point de vue réflexif individuel, surgi par accident.
La réflexion, même la plus critique, peut, au contraire, être envisagée comme un propos transmis, traditionnel, tout autant que sont traditionnels les thèmes particuliers et les formes langagières et poétiques. Il peut donc y avoir cohérence du poème (et, de fait, l’ensemble des parties de l’Iliade renvoient les unes aux autres) sans la position d’un tel démiurge. Ce qui anime, et enrichit la composition peut être un propos partagé, et cela d’autant plus que c’est la forme épique particulière à l’épopée monumentale, forme qui peut comme toute autre s’apprendre, devenir un métier, qui est la garante de la cohérence de l’ensemble, et non une thèse sur le monde ou sur les récits existants, comme c’est le cas dans l’épopée non monumentale et théologique d’un Hésiode, qui, pratiquant une autre forme de systématisation, plus spéculative et non immanente, du mythe, renvoie plus sûrement à un propos individuel, comme c’est le cas pour les systèmes théoriques postérieurs. La forme différente des poèmes homériques et hésiodiques oblige à poser autrement la question de l’auteur, même si ces poèmes sont contemporains.
Le proème de l’Iliade et la question posée par le poème
Une lecture des sept premiers vers de l’Iliade donnera des éléments pour cerner la question qui sous-tend le récit. Il s’agit du « proème ». Nous savons qu’il en existait plusieurs versions. La formulation qui nous est donnée par les manuscrits médiévaux est plus complexe, difficilior ; elle est surprenante et ouvre par là des pistes d’interprétation :
La colère, déesse, d’Achille fils de Pélée, chante-la,
L’exécrée, qui imposa aux Achéens des milliers de douleurs,
Et jeta dans l’Hadès d’innombrables âmes solides
De héros, et d’eux fit le butin des chiens
5Et de tous les oiseaux – la volonté de Zeus s’accomplissait –,
Chante depuis le premier moment où dans leur querelle se désunirent
L’Atride seigneur des hommes et le divin Achille.
L’exécrée, qui imposa aux Achéens des milliers de douleurs,
Et jeta dans l’Hadès d’innombrables âmes solides
De héros, et d’eux fit le butin des chiens
5Et de tous les oiseaux – la volonté de Zeus s’accomplissait –,
Chante depuis le premier moment où dans leur querelle se désunirent
L’Atride seigneur des hommes et le divin Achille.
Le mot « colère », comme cela a été souvent souligné, surprend, car il désigne habituellement une colère divine, plutôt qu’humaine. Dans le récit, c’est Apollon qui, le premier, se verra attribuer une telle colère (v. 75). Un devin dira que la peste envoyée par le dieu et qui, comme la colère d’Achille, ensuite, détruit de nombreux Achéens, est due à sa colère (mênis), à cause du refus d’Agamemnon de rendre sa fille au prêtre d’Apollon Chrysès. Dans le proème, la colère d’Achille est présentée pour elle-même, sans circonstance explicative. Ses effets sont immenses : non seulement la mort de très nombreux Achéens, mais le fait qu’ils seront laissés aux bêtes, comme « butin » [9] , sans rite funèbre, contrairement à toute norme. Or, comme on le sait, ce désastre n’est jamais raconté dans l’Iliade. C’est la seconde surprise. Ce texte introductif présente sa propre version de la défaite, provisoire, des Achéens. Il en fait un mal absolu. Les héros morts sont niés comme héros, sans tombeau, sans rite possible, et donc sans culte de leur mémoire. La colère prend matériellement une portée universelle négative. On observe là, comme pour le mythe de Briarée, un phénomène de condensation : les héros meurent en masse, et cela rappelle le mythe d’une destruction, voulue par Zeus, de l’ensemble de la race des héros (mythe raconté, semble-t-il de manière linéaire, dans les Chants Cypriens [10] , et rappelé par Hésiode dans le « Mythe des races » des Travaux et les jours); l’absence de rite donne un caractère non noble à leur mort, comme mourront sans sépulture les Achéens lors de leur retour par mer après la prise de Troie (cf. Philippe Rousseau). La colère d’Achille a donc ici la puissance qu’a dans d’autres récits la décision de Zeus de supprimer définitivement cette forme d’humanité. Mais ici, ce désastre collectif est rapporté à un affect particulier, au sentiment dévastateur d’Achille, qui a une puissance divine. L’écart entre cette présentation de la colère et la suite du poème (où, encore une fois, il n’y aura pas de description de cadavres laissés en masse sur le champ de bataille) montre que nous ne sommes pas là dans l’ordre du récit, que nous n’avons pas affaire à un événement qui entre dans une série, dans une histoire où les faits s’enchaînent, mais dans la présentation d’une singularité scandaleuse et radicale : un affect détruit un nombre illimité de héros. Une tonalité est posée, qui sera sous-jacente au récit. Un thème est défini : un comportement affectif d’aliénation (puisque Achille n’est plus lui-même) qui détruit un ordre social, selon les deux aspects de la crise, subjectif et objectif, que nous avons rappelés plus haut.
Puis, au vers 5, le proème introduit brutalement, dans une incise non reliée syntaxiquement au reste, une seconde instance, qui est d’un tout autre ordre : « et se réalisait la volonté de Zeus. » L’accident de la colère, qui transgresse toute norme (colère divine pour un humain, destruction ignoble), obéit en fait à une norme, celle que pose la volonté de Zeus, comme dieu suprême, garant de la cohérence du monde, de sa rationalité. Le mot pour « volonté », boulê, indique qu’il y a eu délibération de Zeus, prise de décision rationnelle, sans colère. Le contenu de cette volonté n’est pas mystérieux. Il s’agit bien, comme le pensait Aristarque, de la destruction de nombreux Achéens, mais les raisons n’en sont pas données. La volonté divine est présentée comme un fait, inexpliqué. Aucune médiation entre l’affect déviant et singulier d’Achille et la « légalité », au sens de régularité au sein d’un ordre universel, n’est posée. La coïncidence des deux est un pur fait et, dans son opacité, ouvre la question d’une interprétation : comment comprendre qu’un tel débordement de violence, qui écarte les Achéens de la victoire promise sur Troie, qui transgresse dans ses effets le code héroïque, qui fait qu’Achille s’échappe à lui-même, puisse être voulu par Zeus, puisse correspondre à la qualité du dieu comme autorité garantissant l’ordre des choses ? Deux modes d’universalité sont exposés : l’un, matériel, comme expansion désastreuse d’un sentiment individuel, l’autre comme règle divine, comme exercice d’un pouvoir légitime. L’énigme porte sur le lien entre ces deux réalités, pour le moment non reliées.
La fin du proème introduit encore un autre mode de présentation du désastre, avec la phrase « Chante [11] depuis le premier moment où dans leur querelle se désunirent / L’Atride seigneur des hommes et le divin Achille ». On entre seulement là dans le récit, dans une suite logique (avec une causalité), où une irréversibilité est signalée, avec un ordre des moments (« le premier »), et une origine. Un troisième terme marque ce passage au récit : après des réalités individuelles et souveraines, la colère d’Achille, la volonté de Zeus, apparaît un conflit, une division, avec la querelle des deux chefs, Agamemnon et Achille, le premier étant présenté comme politiquement puissant (« seigneur des hommes »).
Le thème de l’Iliade, la colère d’Achille, est ainsi exprimé selon trois ordres différents de présentation, qui ne sont pas articulés entre eux mais seulement juxtaposés : un état prenant une forme absolue (un sentiment et une destruction généralisée) ; une règle (Zeus), non motivée ; puis un conflit entre deux individus. C’est ce conflit qui introduit la dimension temporelle du récit, qui sera le support de l’ensemble du poème. Mais le récit est préparé par la présence de deux instances non narratives qui entretiennent une relation de tension maximale entre elles, la déviance individuelle, humaine mais de force divine, et l’ordre divin. Le récit développera les étapes d’une querelle, débouchant sur une crise de la société achéenne, mais le conflit de légitimité et l’aporie du système normatif seront, pendant l’écoute de ce récit, en permanence confrontés d’une part au fait, non conflictuel, absolu, de la colère et, de l’autre, à la règle divine, elle-même non conflictuelle et absolue, représentée par la volonté de Zeus. Ces deux instances qui transcendent le récit seront dans la suite du texte elles-mêmes produites par le récit (il faudra la colère d’Apollon, puis celle d’Agamemnon [12] pour produire, enfin, celle d’Achille, de même que la volonté de Zeus sera un événement rentrant dans une série d’actions divines, avec l’intercession de Thétis), mais elles resteront présentes comme les pôles encadrant le récit.
La tension que forme la polarité colère d’Achille-décision rationnelle de Zeus pose d’emblée la possibilité que l’événement déviant, singulier, ait un sens. Elle signale aussi que le sens est à trouver au-delà du conflit entre les deux chefs Agamemnon et Achille, au-delà des enjeux politiques et humains de leur querelle : au-delà des normes et de leur fonctionnement, il existe un ordre, énigmatique, qui dote de signification l’irruption irrationnelle de la singularité. Comment quelque chose comme un ordre en vient à se réaliser à travers ce désordre extrême, selon le schéma de ce qu’on peut appeler une ruse de la raison ? Le proème, dans cette version, adresse cette question à la matière narrative que reprendra le texte.
Proème et récit. Peirce
Avant d’en venir au contenu propre du thème comme colère, il n’est pas inutile d’examiner les contraintes que cette composition du proème imposent à toute tentative d’interprétation. Quel modèle proposer ? Trois ordres distincts, discontinus, sont énoncés : la colère, la volonté divine, la querelle entre des volontés particulières. On voit par là qu’une lecture de type narratologique du début de l’Iliade, mais aussi du récit, manquerait son objet. Elle partirait du constat que conformément à la dynamique des récits, il y a temporalité et intrigue du fait de l’opposition de deux actants, le Sujet et l’anti-Sujet (cf. A. J. Greimas [13] ), le récit étant le développement de leur antagonisme, avec les instances permettant à leur conflit de se déployer dans des formes diverses. On pourrait ainsi lire le début du poème comme un enchâssement de conflits : Apollon/Agamemnon, Achille/Agamemnon. Mais une telle lecture se donne comme acquis, comme point de départ ce qu’elle devrait au contraire produire. It begs the question. Cela vient du fait que le temps, dans ce modèle, est celui des actions représentées et qu’il est pensé indépendamment du milieu matériel du récit, à savoir le discours, comme pratique langagière. Si l’on suit le discours, et non l’action, l’antagonisme des Sujets (Apollon, Agamemnon et Achille) est second, même s’il est premier dans la diachronie. Cette diachronie n’est pas immédiatement donnée. Elle a comme condition deux ordres de réalité qui échappent à la temporalité : la colère, comme affect pur, autosuffisant et s’emparant du réel, comme état, puis la volonté de Zeus, qui englobe le temps et le clôt, et peut donc être présentée comme une réalité intemporelle, donnée comme un tout où décision et accomplissement coïncident.
Le proème montre les conditions d’une apparition du temps du récit, à partir du jeu de deux instances non diachroniques que sont la mênis et la volonté de Zeus. Le temps, qui est bien celui d’un antagonisme entre individus, se répercutant sur d’autres antagonismes, entre les dieux, entre Grecs et Troyens, entre Hector et Pâris, Hector et Achille, etc., n’est pas une donnée première ; il est lié à la tension entre deux absolus, l’affect irrationnel, statique, invariant d’Achille et la rationalité d’une volonté divine encore non comprise dans ses motifs.
Par ailleurs, le modèle narratologique, qui se veut applicable à tout récit, ne rend pas compte des enjeux particuliers de la crise introduite par le troisième niveau (celui de la querelle entre Agamemnon et Achille). Il ne s’agit pas de n’importe quelle crise, mais d’un dysfonctionnement qui atteint une dimension universelle doublement, par la masse des tués, par l’intervention de Zeus, et qui met en péril l’ensemble du « monde » au sein duquel les actions héroïques peuvent prendre un sens. La composition du proème, dans sa discontinuité, qui fait de la querelle l’un des modes seulement de présentation du thème général du poème, vise précisément à dégager, de manière encore inarticulée, cet enjeu universel.
Un autre modèle théorique semble plus à même de rendre compte de la genèse du récit au sein du poème et de sa portée. Il a une valeur empirique, c’est-à-dire adéquate à la dynamique du texte, visiblement plus grande, même s’il ne vient pas de la philologie. Il s’agit, de la distinction des modes d’être qu’opère Charles S. Peirce dans des textes de 1903-1904, avec ses trois catégories fondamentales [14] :
- la « priméité » (‘firstness’), comme catégorie du sentiment et de la qualité (« par sentiment, j’entends un cas de ce genre de conscience qui n’implique aucune analyse, comparaison ou processus que ce soit », p. 84) ; « le présent immédiat », p. 98 ; l’inconditionné ; dans le cas d’Achille : le sentiment, l’affect qui produit une qualité indépassable, immédiate, du réel, dans un désastre généralisé ;
- la « secondéité » (‘secondness’), comme catégorie de l’expérience, de la lutte et du fait (notre troisième dimension, avec la querelle) ; « la secondéité est le caractère prédominant de ce qui a été fait », p. 98. Une intervention particulière, qui tranche avec le caractère indistinct, immédiat et global de la première catégorie ;
- enfin, la « tiercéité » (‘thirdness’), comme catégorie de la pensée et de la loi (la volonté de Zeus), qui donne sens aux événements brutaux, tranchants, de la seconde catégorie dans leur rapport avec la qualité uniforme de la première.
Il ne s’agit pas de proposer une interprétation philosophique de l’Iliade, de prendre plaisir à y retrouver, tant bien que mal, sur le mode de l’allégorie, l’écho anachronique de modèles conceptuels plus récents. Tout au contraire, le propos est de repérer les instruments théoriques qui permettent de répondre concrètement à notre question : comment se met en place la temporalité du récit, avec quel sens ? Il reste à examiner la pertinence de ces modèles pour notre texte, avec, pour le moment, l’intuition que celui de Peirce, par la temporalité qu’il suppose dans le rapport entre ses trois catégories, peut fournir un outil pour comprendre la temporalité du récit, qui n’est pas un simple espace donné au préalable et permettant de déployer les épisodes d’un antagonisme (selon le modèle narratologique courant). Peirce permet de comprendre le temps comme le milieu d’une interprétation (la découverte de la régularité, de la raison d’être des événements), qui n’intervient qu’après coup. La tension entre les trois niveaux de réalité que nous avons repérés ouvre une dimension temporelle, parce que rétrospective, de compréhension.
Une lecture même rapide des discours antagonistes dans les querelles humaines et divines qui jalonnent l’ensemble du poème montre, de fait, qu’ils ne se contentent pas d’affirmer des points de vue particuliers, en face à face, par rapport à une situation donnée, mais qu’ils mobilisent chaque fois une représentation du tout de la guerre de Troie, avec cette ironie que les dieux, censés ordonner ce tout, sont soumis au même régime. Le récit avance par une série d’interprétations contradictoires et construites rétrospectivement de l’ensemble de l’histoire, et par les actions découlant de ces interprétations, humaines et divines. On assiste ainsi à une confrontation permanente entre, d’une part, des arguments qui contextualisent les moments dans la perspective globale du devenir des Achéens et de Troie et qui pour cela se réfèrent aux valeurs générales et aux normes des acteurs (leur « monde vécu »), et, de l’autre, l’événement critique, radicalement singulier, hors normes, de la colère.
Sur le contenu du thème
Si l’on s’intéresse maintenant au contenu de cet ordre tenu par Zeus et du problème qu’il a à régler, on voit, comme l’a proposé Heinz Wismann lors de la présentation orale de ce texte en janvier 2012 [15] , que l’épopée d’Homère organise la diversité des événements particuliers qu’elle va raconter à partir d’une autre perspective que celle développée par l’épopée hésiodique. Alors qu’Hésiode déploie un schéma naturel, par la généalogie, d’organisation de la diversité du divin et du réel en général (que les dieux ont la charge de gérer) selon une perspective qui soumet le réel à la régularité d’une phusis – cette perspective étant reprise par les philosophes en continuité avec Hésiode –, l’épopée homérique (et cela vaut aussi pour l’Odyssée), ne rassemble pas le divers sous l’idée de nature. Le thème de l’Iliade est « éthique » (la colère). Et de fait, le poème soumet la diversité des événements à la tension propre à un êthos, à une subjectivité affective qui se perd, et qui par là devient singulière, et qui ne se retrouve qu’après la mort du double qu’est Patrocle, l’ami aimé tué par Hector dans les armes prêtées par Achille : cette mort confronte Achille à lui-même, à la perte de soi qu’il peut désormais objectiver ; ce n’est qu’après cette expérience dévastatrice qu’il redevient guerrier, mais non pour être le guerrier fonctionnel qu’il était auparavant, comme participant à un système normatif qu’il accepte, comme « meilleur des Achéens » venu défendre les droits de Ménélas face à Pâris, mais par vengeance individuelle. Éthique, comme cela a été précisé dans la discussion, est ici à prendre au sens large, incluant l’ensemble des rapports humains et divins, puisqu’il s’agit par le déchaînement irrationnel de cet affect d’une catastrophe touchant l’ensemble des systèmes sociaux, humains et divins et non pas seulement un individu au sein d’un tout constitué qui, lui, resterait inchangé.
La mention de la « volonté de Zeus » au vers 5 indique que l’ensemble de ce processus, crise, affect, retour à soi, mais autrement, est tenu par une décision divine qui en assure la cohérence, même si les normes humaines et divines ont été mises à mal par son déclenchement. Toute lecture fonctionnaliste de l’Iliade comme expression et consolidation de codes sociaux préexistants est ainsi à côté de son objet.
La différence de forme entre les deux épopées (monumentale et héroïque, chez Homère, non monumentale et théogonique, chez Hésiode) est sans doute à interpréter non comme une différence de « choix esthétique » ou de conviction, mais comme une différence de fonctionnement des deux idées sous-jacentes, êthos et phusis. Alors que l’épopée naturelle, généalogique, recherche, par la généalogie, les causes des phénomènes (divins, puis physiques dans les systèmes cosmogoniques) en les soumettant d’emblée à une exigence d’unité, et peut donc se contenter de seulement mentionner les événements ainsi « réduits » et expliqués [16] , l’épopée d’orientation éthique, au sens large, part des situations, des affects comme donnés, et, au lieu d’en chercher simplement les causes, de les « réduire », elle en déploie au contraire les implications après coup dans des récits complexes. C’est la même machinerie divine qui sera mobilisée, avec ses histoires, ses rebondissements que dans l’épopée théologique, mais dans un but différent : dans un cas, l’analyse du sens au sein du monde vécu des acteurs ; dans l’autre, la réduction causale.
D’un point de vue plus général, l’un et l’autre principe, la nature et le caractère, prennent ici leur sens dans l’horizon intellectuel de ce qu’on peut appeler un moment « ancien » (et non d’un monde moderne ou contemporain) à savoir d’un moment historique organisé selon une raison de type « cosmologique », au sens où le désordre est dirigé et mené à son terme par une instance qui établit l’ordre des choses (Zeus), au sens où la crise n’ouvre aucune perspective autre, dans l’idée d’un « salut » ou d’une transformation radicale de l’ensemble du donné, de ce qui existe, comme ce sera le cas pour un monde porté par l’histoire et son ouverture. Nous sommes dans un monde fermé, où ce qui peut avoir lieu est déterminé par des décisions antérieures, qui sont de l’ordre de la Moira. Mais, le point important pour l’Iliade est que, dans le récit, ce monde ne se clôt que par le déchaînement de forces qui n’entrent pas dans un jeu réglé d’avance et prévisible. La cohérence du tout ne relève pas d’un ordre préalable et obvie des choses, mais de la capacité du récit à articuler les deux pôles contraires qu’il énonce, abruptement, en son début (la colère, la volonté de Zeus). Il mobilise pour cela les représentations traditionnelles censées rendre la vie praticable dans un ordre donné et les confronte à une situation de déviance.
Par ailleurs, pour revenir sur la question de la périodisation d’une évolution intellectuelle dans la Grèce archaïque, on voit encore plus clairement qu’il est erroné d’opposer à un monde « objectif », qui serait celui de l’épopée, conçu comme monde plein, tenu par des normes contraignantes humaines et divines, le monde « subjectif » qui naitrait avec l’émergence de l’individu, de la prise en compte de ses passions propres, de ses déviances, telles qu’on les voit exprimées dans la poésie lyrique (à partir des VIIe et VIe siècles) et qui aurait son correspondant rationnel dans la définition d’une liberté des individus au sein des cités. L’Iliade se donne la déviance subjective comme thème et tente de la rationaliser dans une forme narrative. Cette rationalisation n’est pas limitation, contrôle de l’affect (comme ce sera le cas dans les systèmes éthiques normatifs), mais elle passe au contraire par son exacerbation. En ce sens, l’épopée est proche de la tragédie (que Greg appelle new epic), mais dans un autre contexte et avec d’autres visées. Dans les deux cas l’intériorité singulière est publique et envahit le monde politique.
Les deux cités
Il est temps de se demander si l’irruption de la singularité destructrice et de la loi divine qui lui donne sa puissance est accidentelle, extérieure au modèle politique humain qu’elle détruit ou si elle lui est intrinsèquement liée. L’hypothèse sera que la crise est suscitée par la nature même du modèle qu’elle affecte.
L’antagonisme des deux rois concerne le partage du butin. Après la prise d’une ville proche de Troie, Thèbe, les Achéens se sont répartis les prises (récit d’Achille à sa mère, v. 366-369) :
Nous sommes allés à Thèbe, la ville sacrée d’Éétion,
Nous l’avons dévastée totalement et emportâmes tout de là-bas,
Et ce tout, les fils des Achéens le partagèrent correctement entre eux ;
Pour l’Atride, ils prirent Chryséis aux joues si belles.
Achille a été doté de la jeune Briséis. La répartition n’est pas le fait du roi Agamemnon, mais de tous. Achille répète que ce sont les Achéens qui lui ont donné Briséis. Le partage ne se fait qu’une seule fois, les parts d’honneur ne sont pas à reprendre. La répartition ne se fait pas selon le mérite des guerriers (qui, par leurs actions, apportent la richesse à la communauté, ils ne la produisent pas), mais selon le rang. Agamemnon, comme « roi le plus roi », en responsabilité de l’expédition punitive contre Troie, reçoit plus. C’est la règle, qui est admise, même si elle suscite des protestations quand le système est mis en cause (Achille à Agamemnon, v. 163-168) :
Jamais je n’ai part égale à la tienne, quand les Achéens
Ont dévasté une citadelle bien peuplée des Troyens.
165Mais la part la plus grande du combat qui multiplie les assauts,
Mes mains l’exécutent. Mais quand arrive le partage,
Ta part est beaucoup plus grande, et la mienne est de peu, et choyée,
Quand je l’emporte vers les bateaux, puisque j’ai peiné au combat. [17]
Il y a une inégalité du partage, et un rapport arbitraire des résultats de ce partage avec le « travail » qui fournit les biens à répartir, mais cette inégalité reproduit un ordre social préétabli qui est accepté en ce qu’il garantit à chacun des rois présents un « honneur », censé être irréversible, puisque les biens ne peuvent être redistribués (Achille à Agamemnon, qui réclame une nouvelle captive, v. 122-126) :
Très glorieux Atride, le plus âpre au gain de nous tous,
Comment les Achéens à la grande ardeur te donneront-ils une part ?
Nous ne savons pas qu’il y ait une réserve abondante commune.
125Mais ce que nous avons pillé dans les cités est partagé.
Et il n’est pas décent de l’ôter au peuple pour une collecte nouvelle…
Le système repose sur la reconnaissance réciproque des dignités et des valeurs. Cette reconnaissance à la fois fait que les Achéens se retrouvent pour procéder au partage et résulte du partage. Elle se vérifie chaque fois et se maintient, dans une relation de face à face qui perpétue les dignités. On a donc un modèle spatial du lien politique, avec la mise en commun du butin, quel que soit le mérite particulier dans l’action guerrière. La règle commune est légitime du fait de l’évidence du bien fondé du partage, qui confirme la règle. Ce modèle, comme l’ont souligné des historiens tels que Diego Lanza, présidera à la constitution des cités, d’abord aristocratiques puis démocratiques par un élargissement du nombre des citoyens associés au partage. La norme fondamentale ne changera pas.
C’est, dans le cas du camp des Achéens, un modèle strictement spatial, sans tradition, sans mythe de fondation et héros fondateurs, sans autorité surplombante. Agamemnon est d’abord garant, par le salut de l’armée qu’il assure, de la possibilité d’appliquer des normes. On a affaire à un modèle visible, immédiatement vérifiable, fondé sur un principe de répartition des dignités. Ainsi, ce n’est pas Agamemnon qui convoque l’assemblée des guerriers, mais Achille (I, 55).
Ce modèle suppose que les « biens » (les captives) valent comme des objets particuliers auxquels s’applique une règle générale de répartition. Ils ne valent pas par eux-mêmes. Ils sont l’équivalent matériel et symbolique de la dignité des participants et peuvent s’échanger entre eux. Ainsi Agamemnon, dépossédé de sa captive, l’échangera contre celle d’Achille. On n’est pas, avec cette norme, dans l’ordre du singulier. La cohérence politique du tout est assurée par le bon fonctionnement de la norme, ce fonctionnement relève du droit, comme attribution à chacun de ce qui lui revient. S’il y a lésion, l’affaire est juridique : dans sa protestation, Achille évoquera le lien entre la forme du sceptre qu’il tient dans l’assemblée pour parler, sceptre commun aux participants, et la rectitude d’un jugement valide (Achille à Agamemnon, v. 233-239) :
Mais je te le dis et j’en jure le grand serment,
Par ce sceptre, qui jamais en feuilles ou en branches
235Ne poussera, car pour toujours il a quitté l’arbre taillé dans les montagnes,
Et ne reverdira pas. Car tout autour le bronze arracha
Feuilles et aubier. Désormais, les fils des Achéens le
Portent dans leurs paumes, en officiants de justice, eux qui gardent
Les prescriptions (themistes) venues de Zeus. Il sera pour toi un grand serment.
La cité que forme le camp achéen ne tient que par la réalisation des droits particuliers de chacun ; elle n’est rattachée à aucune origine commune, à aucune tradition fondant une totalité supérieure aux individus. Cela est liée à la raison d’être de cette cité : le motif du rassemblement des Achéens, de l’existence de ce « tout » de la cité n’est pas « naturel » (une autochtonie, un passé), mais purement contractuel : l’engagement qu’ont pris les rois achéens de défendre le droit de Ménélas et d’obtenir réparation des Troyens. Orientée vers une action d’ordre juridique, sans passé, cette cité est sans temples, sans tombeaux, sans femmes, à part les captives, sans enfants, sans espaces de production, mais elle a les caractères de l’espace public des cités, comme lieu de face à face et de reconnaissance. Cette cité hors sol, hors temps, possède les instances de décision qui caractérisent l’espace normé des cités traditionnelles (un Conseil, une Assemblée). Dans le cours du récit, quand la pression des Troyens sera trop grande, elle se dotera d’un rempart, dans une sorte de contre-image de Troie. On peut donc tenter l’hypothèse que le camp achéen comme cité déplacée et fonctionnelle représente, dans sa pureté, un modèle politique, modèle contractualiste et non naturel.
L’hypothèse est renforcée par le fait que cette cité artificielle, strictement politique, a son contraire, dans la ville de Troie, cité naturelle, où les richesses et les troupeaux prolifèrent, centrée sur une famille royale elle-même proliférante, celle de Priam et d’Hécube, avec une architecture qui, pour le palais royal reproduit cette fertilité expansive (avec les maisons des princes, sauf celle de Pâris, rattachées à celle du couple royal), avec des remparts construits par les dieux. Cette cité est d’abord choyée par Zeus en raison de la richesse des cultes qu’elle lui rend. On reconnaît là les caractéristiques de la troisième fonction de Dumézil, mais aussi l’efficience d’un modèle politique, où la norme est fondée en nature, et non sur un simple contrat. Il n’est pas improbable que, face au camp achéen, cette cité, qui diffère aussi des cités d’origine des rois venus à Troie, représente pour les compositeurs de l’Iliade un type oriental.
Liée au temps, à l’histoire, par ses origines divines complexes, cette cité contient en elle-même son principe menaçant. Dans sa réussite heureuse, elle est rattachée à Aphrodite, qui est à la fois force interne de prospérité et aussi danger (d’où l’extériorité de la maison de Pâris, qui, du dehors, apporte la ruine avec Hélène).
Pour mieux saisir la relation entre ces deux cités, il faudrait reconstruire la logique propre à une troisième, celle des dieux dans l’Olympe. Cette cité a des traits des deux cités humaines, comme lieu d’un partage entre les dignités (mais partage advenu une fois pour toutes) et comme histoire. Il y a sans doute là moins un modèle politique que la mise en place d’une instance capable d’assurer son sens au récit du conflit entre les deux cités humaines et d’absorber les contradictions que le récit des événements humains fait surgir avec le déclenchement de la déraison singularisante d’Achille. Une instance non seulement normative, mais aussi interprétative et déterminante des situations.
Crise et singularité
D’où vient la crise du modèle achéen, qui est un système de régulation, par le partage comme règle générale, des relations entre particuliers ? Elle vient, je crois, de l’irruption, au cœur de ce modèle spatial, du singulier, de l’histoire, qui fait que l’un des biens distribués, une captive, ne peut valoir comme signe d’une valeur, ne peut s’échanger, mais vaut d’abord seulement en soi. Chryséis, la captive d’Agamemnon, est la fille d’un prêtre aimé d’Apollon, et le dieu imposera sa restitution en détruisant partiellement, comme le fera plus tard Achille, la société du partage par la peste. Le prêtre, d’abord, arrive bien avec une rançon pour racheter sa fille, mais cette rançon est « infinie » (I, 13), et la colère d’Apollon, devant le refus d’Agamemnon de céder, désigne la valeur absolue, et non relative, de Chryséis. Si cette fille a une histoire qui la rapproche des dieux, elle ne peut entrer dans un système de partage et d’échange. Et si elle sort de ce système, celui-ci s’effondre : Agamemnon est désormais sans « part d’honneur ». Achille lui propose bien d’attendre que les Achéens aient pris Troie ; il obtiendra alors beaucoup plus que Chryséis, mais la proposition ne tient pas, car dans l’espace public de reconnaissance immédiate, visible des dignités, qui est la norme fondamentale de cette société, le roi sera démuni. Il refuse de s’en remettre au temps et d’attendre, avec la prise de Troie, l’arrivée d’autres captives. Il s’en tient à la logique spatiale, hors histoire, de son système et, du coup, le détruit. Il impose l’échange de Chryséis, désormais perdue, avec Briséis, la captive d’Achille, qu’il s’approprie, transgressant par là la règle du partage.
De l’espace politique au temps du récit
Chryséis cesse d’être fonctionnelle et échappe au système de partage parce qu’elle est une singularité, en relation avec le dieu Apollon qui a dans l’Iliade la fonction précise de désigner les moments singuliers où se nouent les crises (cf. Philippe Rousseau). Achille cesse d’être fonctionnel (comme « meilleur des Achéens », comme « grand barrage contre la guerre ») et devient une singularité, dans sa colère, parce que l’équilibre entre règle générale et reconnaissance des particularités est rompu. Il n’y a plus de règle générale pouvant assurer le respect du particulier. Achille n’est désormais soumis à aucune norme. Il n’en est plus à dénoncer, tout en l’acceptant, la contradiction que lui-même exposait entre l’ampleur de son travail de guerrier et la petitesse de la part qu’il recevait, contradiction qu’il acceptait puisque une règle de reconnaissance était malgré tout appliquée. Achille se met au-delà de toute perspective de reconnaissance, d’échange et de compensation humaine possible. Il ne demande rien, sauf le massacre à venir des Achéens. Il est singulier en ce qu’il s’oppose à tous.
L’imposition par Apollon d’une logique de la singularité, selon une distinction nette entre religion et politique [18] , cause le dysfonctionnement du système politique d’échange et de partage, système qui spatialise le lien politique. Cette revendication produira le récit. Achille, dépossédé de sa timê, de sa part (spatiale) d’honneur, sera contraint à son tour à la singularité radicale, sans médiation, sans négociation possible, dans son sentiment. Il ne trouvera comme moyen d’être honoré par Zeus que la destruction presque totale de la société qui n’a pas su le reconnaître. La part d’honneur [19] devient, par la colère et par l’appui de Zeus, temporelle, et récit.
Footnotes
[ back ] 1. Fondé après le colloque de Lille sur Hésiode (1989), le groupe se réunit régulièrement depuis 1991. Comme toujours, une institution intellectuelle qui a réussi ne pouvait qu’être le fait d’individus qui veulent rompre avec les cadres standard de la communication scientifique. À Pietro Pucci, Gregory Nagy, Philippe Rousseau et moi, qui étions à l’origine du projet, se sont joints comme organisateurs Froma Zeitlin, Claude Calame, Jeffrey Rusten, Andrew Ford, David Bouvier, Fabienne Blaise, Rossella Saetta-Cottone, Anne de Cremoux, accompagnés de beaucoup d’autres et notamment de jeunes hellénistes, dont le travail a toujours été mis au centre des rencontres. Nicole Loraux n’a pu, hélas, qu’y être présente trop peu.
[ back ] 2. Je renvoie ici à l’analyse du fragment 91 par Jean Bollack et Heinz Wismann, Héraclite ou la séparation, Paris, 1972.
[ back ] 3. Dios d’eteleieto boulê. Destin des héros et dessein de Zeus dans l’intrigue de l’Iliade, Thèse d’État, Lille, 1995. La thèse d’ensemble sur l’Iliade est présentée dans « L’intrigue de Zeus », Europe 865, 2001, p. 120-158. Le point où ma lecture diverge de la sienne est le rôle donné au mythe de la fin de la race des héros : s’agit-il, comme je le pense, de l’un des éléments figuratifs traditionnels qu’absorbe le poème pour construire l’histoire d’Achille, qui vaut par elle-même, ou fonctionne-t-il comme un « interprétant » de cette histoire qui, du dehors, lui donne son sens ?
[ back ] 4. Elles reprennent sous une forme élargie un exposé présenté en janvier 2012 au séminaire de Jean-Marc Ferry, Philosophie de la crise (Université de Paris IV). Je remercie Pietro Pucci pour la lecture attentive et critique qu’il a faite de ce texte dans sa forme première. Il reconnaîtra les effets de notre discussion.
[ back ] 5. Dans son livre Raison et légitimité. Problèmes de légitimation dans le capitalisme avancé (1973), trad. fr. par J. Lacoste, Paris, 1978, premier chapitre, « Un concept de crise dans les sciences sociales ». Le modèle complexe de la crise proposé dans cet ouvrage vise à dépasser les difficultés théoriques et empiriques que rencontrent les modèles qui ou bien s’en tiennent à l’aspect systémique des crises, ou, au contraire, insistent d’abord sur la perception subjective des agents et sur leurs motiviations. Le modèle tente d’articuler entre elles les deux dimensions de la vie sociale que sont le système et le monde vécu, d’où son intérêt.
[ back ] 6. C’est l’idée habituelle, partagée tant pas les philosophies de l’esthétique que, souvent, par la science philologique, de l’épopée comme image d’une monde « plein », cohérent, où destin des héros, langue, et intérêt du public coïncident.
[ back ] 7. Je m’appuie ici sur l’analyse de cet épisode par Greg, qui l’avait présentée oralement lors de la première réunion de CorHaLi à Cornell, en 1991 : « Mythologicum exemplum in Homer », dans R. Hexter et D. Selden (éds), Innovations of Antiquity, Londres, 1992, p. 311-331.
[ back ] 8. D’où une hypothèse, possible mais infalsifiable, sur la présence d’Apollon dans la triade des rebelles selon la version de Zénodote : le dieu, protecteur de Troie et d’Hector, verra son protégé condamné à disparaître du fait de la colère d’Achille et de ses conséquences.
[ back ] 9. Le terme anticipe l’enjeu de la crise du chant I.
[ back ] 10. Mais ce poème ne devait pas être « simple », selon le témoignage qui nous dit que le dieu Mômos, « Blâme », y a suggéré à Zeus, qui voulait simplement supprimer la race humaine, d’utiliser pour cela Hélène et Achille. La « gloire » des héros, dans l’épopée, dépendait donc, ironiquement, de la puissance du dieu tutélaire de la poésie inverse, celle du blâme et non de l’éloge (voir la scholie D à Iliade I, 5).
[ back ] 11. Ce mot, repris du premier vers, est rajouté par la traduction.
[ back ] 12. Agamemnon est le deuxième personnage, après Apollon, à se voir doté d’une colère qualifiée de mênis, au vers 247. La colère d’Achille ne sera mentionnée dans le récit qu’au vers 420, dans l’ordre que lui donne Thétis : « sois en colère. »
[ back ] 13. Du sens. Essais de sémiotiques, Paris, 1970.
[ back ] 14. Cf. Écrits sur le signe, trad. fr. par G. Deledalle, Paris, 1978, p. 69 ss.
[ back ] 15. Cf. supra n. 4.
[ back ] 16. Il est vrai, comme me le fait remarquer Pietro Pucci, que le poème d’Hésiode ne suit pas toujours ce modèle naturaliste. La race humaine, dans sa spécificité et sa séparation d’avec les dieux, n’est pas produite généalogiquement ; il n’y a pas d’anthropogonie, au sens strict, dans ce texte (on ne trouve qu’une seule allusion à une origine naturelle possible de l’humanité au vers 889, avec l’expression « les hommes nés du sol », mais le poème ne raconte pas cette histoire, par ailleurs connue, cf. par exemple Deucalion). L’humanité est le produit d’une situation symbolique, artificielle, avec la ruse de Prométhée, qui est à l’origine du sacrifice. Hommes et dieux se séparent non par nature mais à l’occasion de la fondation d’une institution ; et la première femme, qui donne aux hommes leur temporalité, est un artifice. Cette dualité des principes dans le poème (nature / pratiques symboliques) témoigne d’une capacité de la pensée narrative de type systématique, comme celle qui préside aux théogonies, de distinguer les ordres de sens, avec la distinction entre, d’une part, la réalité immédiate de la vie humaine, comme domaine d’expériences, avec les limitations qui le constituent, et, d’autre part, l’ordre naturel des dieux, dont l’histoire désormais close établit le fondement universel, nécessaire, de ce domaine. Cette poésie articule physique et éthique, avec, toutefois, la prédominance du point de vue « naturel », puisqu’il apparaît que les dieux hésiodiques, une fois qu’est instauré l’ordre immuable de Zeus, ont besoin de l’humanité, qui introduit dans l’univers ainsi stabilisé un principe de différence et d’ouverture du devenir qui ne menace pas cet ordre divin. Voir, entre autres, plusieurs des études rassemblées dans le livre Le Métier du mythe. Études sur Hésiode (éd. par Fabienne Blaise et al.), Lille, 1996 et mon texte, « Refaire le présent. Hésiode et Archiloque », dans Barbara Cassin et Carlos Lévy (éds.), Genèses de l’acte de parole dans le monde grec, romain et médiéval, Turnhout, 2011, p. 29-59. [ back ]
[ back ] 17. À ce stade de la querelle, Achille dit accepter cette règle, bien qu’elle soit injuste. Au chant IX, il fera de cette injustice principielle la raison de son refus de revenir (v. 315-334).
[ back ] 18. Cela montre déjà que la « société homérique » était plus différenciée, au sens wébérien, qu’il n’est en général admis.
[ back ] 19. Cf., dans le discours de Thétis à Zeus, l’insistance mise sur la timê : I, 505, 507, 508.